Après la signature d’un accord-cadre à Doha entre la RDC et l’AFC/M23 qui met l’accent sur le cessez-le-feu, le rétablissement de l’autorité de l’État dans les zones occupées, la relance économique, la réinstallation des personnes déplacées, l’identité et la citoyenneté, le chercheur Yvon Muya propose d’analyser les manquements de la paix négociée et les dynamiques communautaires souvent négligées par les cadres diplomatiques.

Par Yvon Muya*, docteur en études de conflits, auteur d’une thèse sur
l’ethnonationalisme et la violence proposée pour le Prix du Gouverneur général du Canada.
Dans le cadre de ma recherche doctorale sur les réponses communautaires à la vulnérabilité sécuritaire dans le Sud-Kivu — recherche couronnée par une proposition au Prix du Gouverneur général au Canada —, j’ai cherché à comprendre comment certaines communautés réagissent à des menaces existentielles en l’absence de protection étatique. Ce que j’ai observé n’est pas une dynamique d’expansion, mais plutôt une réponse à l’insécurité persistante. Dans des zones comme Minembwe, la mobilisation identitaire s’inscrit moins dans une logique idéologique que dans une quête de protection.
Les pourparlers de Doha entre Kinshasa et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, tout comme l’accord de Washington, constituent des avancées diplomatiques significatives. Néanmoins, ces initiatives risquent de négliger un aspect central du conflit : les réactions communautaires face à une insécurité perçue comme structurelle.
Le vide institutionnel incite les communautés à s’organiser elles-mêmes
Pour des groupes tels que les Banyamulenge, la mobilisation communautaire s’inscrit souvent dans une logique de préservation face à une menace permanente. Leur citoyenneté est remise en question, leur présence est niée, et leurs villages sont attaqués. Dans ce contexte, la mobilisation devient une manière de rester visible dans un espace traversé par la peur réciproque de l’effacement. En effet, les Bembe, les Banyindu, les Bafulero et d’autres groupes dits « voisins » expriment eux aussi des craintes profondes, souvent nourries par la mémoire des affrontements passés et la perception d’un danger continu. Chacun se sent insécurisé par l’autre, et réagit selon sa propre logique de protection. Ce climat de suspicion réciproque alimente des cycles de représailles et d’armement, créant un paysage fragmenté où la violence façonne l’identité, et l’identité alimente la violence.
L’État congolais, quant à lui, se trouve confronté à un dilemme sécuritaire. Dans de nombreuses régions, sa présence est intermittente, contestée ou perçue comme partiale. Ce vide institutionnel incite les communautés à s’organiser elles-mêmes, non pas pour défier l’autorité, mais pour pallier son absence. La frontière entre défense et rébellion devient alors poreuse, et l’incapacité de l’État à garantir la sécurité se transforme en facteur d’insécurité.
Doha : un cadre, non une solution achevée
Les protocoles issus des négociations de Doha reconnaissent désormais que la question de l’identité nationale est cruciale pour le retour et la réinstallation des personnes déplacées et des réfugiés. Ils abordent la protection contre la dénationalisation, l’exil forcé et le discours de haine, et promettent une résolution conforme à la législation nationale ainsi qu’aux normes internationales.
Cette avancée mérite d’être saluée. Néanmoins, elle demeure incomplète si elle n’est pas accompagnée d’une reconnaissance des dynamiques communautaires de protection qui structurent les mobilisations identitaires dans l’Est du Congo. La citoyenneté ne peut être restaurée uniquement par des mécanismes administratifs ou juridiques. Elle doit être reconstruite dans les imaginaires collectifs, à travers la reconnaissance mutuelle, la déconstruction des récits d’exclusion, et l’intégration des formes locales d’organisation face à l’insécurité.
En ce sens, les protocoles doivent être enrichis par une lecture sociopolitique des conflits, afin que les principes qu’ils énoncent ne restent pas lettre morte dans les territoires où l’identité est vécue comme une frontière mouvante entre visibilité et effacement. Les discussions futures autour de ces protocoles devraient précisément servir à cet enrichissement, en intégrant les réalités communautaires et les logiques de protection qui structurent les mobilisations identitaires dans l’Est du Congo. C’est pourquoi il est erroné de présenter l’accord de Doha comme une entente de paix définitive : il s’agit d’un cadre, non d’une solution achevée.
La reconnaissance mutuelle comme base de l’unité intercommunautaire
L’accord de Doha fournit un cadre diplomatique structuré, et ses protocoles traitent des enjeux cruciaux tels que la citoyenneté, le retour des déplacés et la relance des services sociaux. Cependant, un cadre aussi bien conçu soit-il, ne constitue pas une solution en soi. Il doit être enrichi par les réalités vécues sur le terrain, par les récits de mobilisation, les peurs réciproques et les logiques de protection communautaire. En République démocratique du Congo, les tensions identitaires ne se résolvent pas uniquement par des mécanismes institutionnels. Elles exigent une reconnaissance mutuelle, une citoyenneté vécue, et une diplomatie capable d’écouter les voix locales. Le chemin reliant Doha, Washington et Goma ne peut ignorer les territoires de l’identité, de la mémoire et des mobilisations. C’est là que se joue la paix véritable.
*Yvon Muya est chercheur en étude de conflits et analyste de politiques publiques basé à Ottawa. Il est chercheur associé à la Chaire de recherche sur les aspirations populaires et mouvements politiques en Afrique francophone de l’Université d’Ottawa. Ancien journaliste politique en République démocratique du Congo, il se consacre désormais à l’étude des violences identitaires, aux conflits politiques et à la conception de cadres politiques inclusifs. Sa recherche doctorale sur les mobilisations communautaires en contexte d’insécurité dans l’Est du Congo a récemment été proposée par le jury universitaire pour le Prix du Gouverneur général du Canada, la plus haute distinction académique du pays.
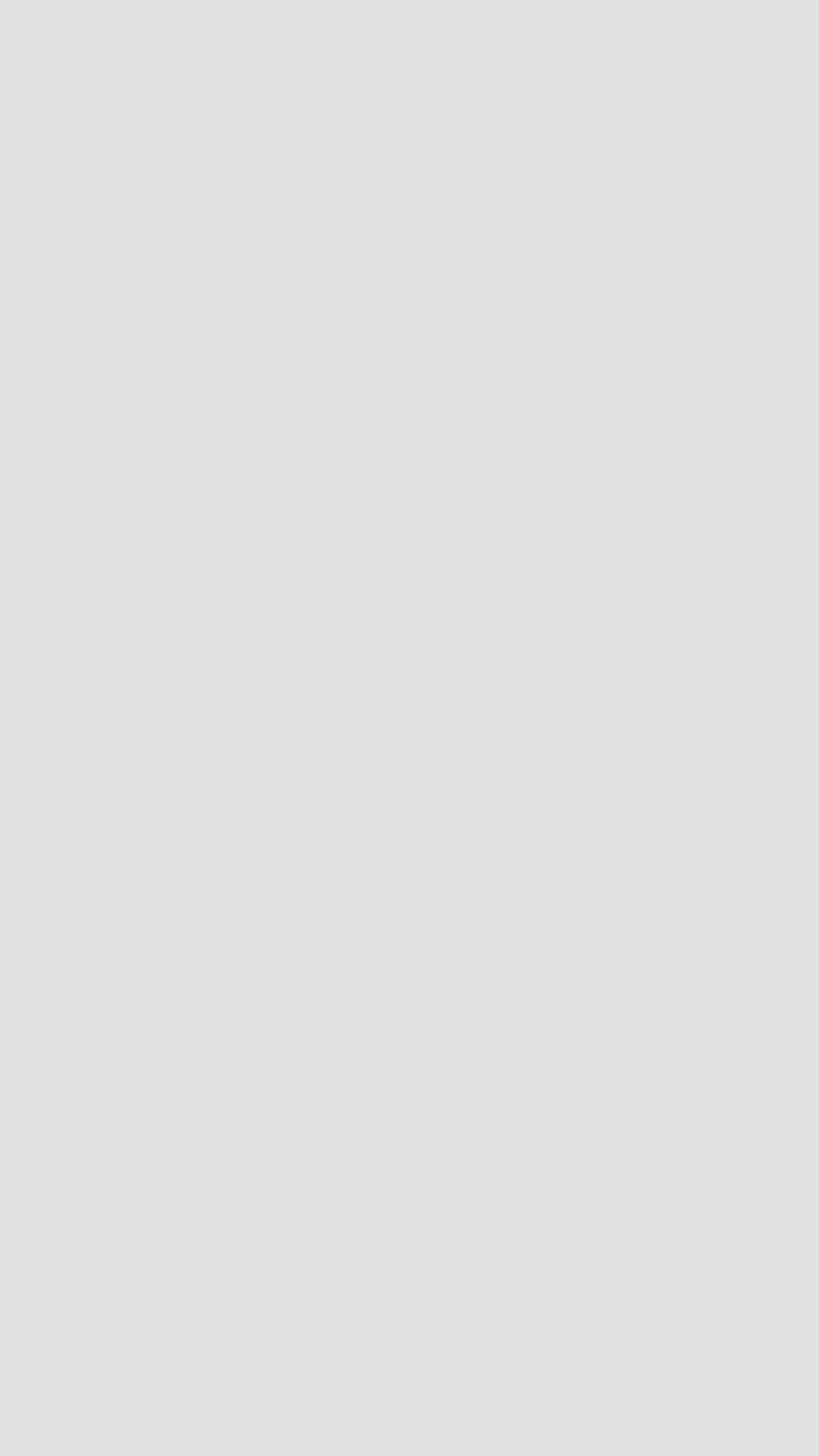

 envoi en cours...
envoi en cours...




















Il est rare de lire une analyse aussi fine et intelligente sur la région de l’Est du la RDC.
Vous identifiez bien les causes profondes des crispations des uns et des autres. Mieux, vous proposez des solutions appropriées. Malheureusement, les leaders politiques congolais s’enfoncent dans la corruption et dans l;insignifiance.
Bravo à Monsieur Muya.
Des telles reflexions devraient être portées dans les plus hautes sphères décisionelles de la RDC. Très souvent les politiciens en quête de conquerir, ou de conserver le pouvoir pensent qu’il s’agit seulement de signer pour la paix sans l’engagement des commuanutés. C’est une grosse erreur, l’une grave d’ailleurs qui est à la base du cycle des violences en RDC depuis 1996.
Bonjour cher frere!
C’est avec une très grande reconnaissance et avec un appétit i.tellectuel que j’ai lu les lignes de votre travail. Vraiment avec un coeur sincère je vous dis merci..
Tu as su avec une étude munitieuse à resprtir de faço claire une plus grande partie du problême de la région des grands lacs. Mais je vais vous informer que les qui de droit le savent et ne veulent pas une solution stable et durable pour la région, du moment où ils viendront à cause des deals économiques il n y aura pas de paix.. Mieux on va nous brûler vivant et nous exterminer tous. Ils doivent venir avec l’humanisme pour résoydre ce problème aussi profond que ce qu’on nous fait croire..On nous a marché sur nos parents pendants des décénies, ils continuent à nous marcher déçu… Que le blanc arrêter ce cinéma. De la base c’est le problème.. N’oublions pas que la bombe d’Hiroshima vient du Kassai.. celui qui comprend comprendra