A la fin du premier jour de son procès, l’accusé a commencé à expliquer sa vie et son œuvre. En finassant sur le moindre détail. Avocats, juges et jurés n’auront pas la partie facile.
C’est une vieille photographie de l’accusé. La seule que reproduisent les médias. Elle le représente sur sa chaise roulante, tentant de sourire malgré l’accident « de roulage » du 27 juillet 1986 qui l’a cloué un an sur un lit d’hôpital avant de le laisser paraplégique. Elle orne le livre « l’Homme et sa croix » paru deux ans plus tard, où Pascal Simbikangwa comparait « l’avant » et « l’après » et tentait d’enjoliver son image. « Avant », c’était la « belle vie ». Celle d’un officier de la Garde présidentielle de Juvénal Habyarimana, une troupe supposée d’élite, où il se voyait lui-même appartenir à la crème de la crème : garde du corps d’un président qui le fascinait, enseignant les sports de combat au camp militaire. « Après », c’était un autre service : patron de la Sûreté, le « Fichier central », où Pascal Simbikangwa se défoulait de son handicap sur les « suspects », du journaliste mal-pensant au petit vendeur de rues qui ne payait pas son écot. Des témoignages recueillis par des enquêteurs du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) puis par les gendarmes du « Pôle génocide » parisien, ont confirmé que le Fichier central avait une sinistre réputation. On commençait par torturer. Puis on demandait à la victime pourquoi on le torturait. Il devait fournir une explication. Il finissait par y arriver.
Quand on croisait le capitaine Simbikangwa , on baissait les yeux
En général, les torturés ressortaient après quelques heures ou quelques jours. Quelques-uns ne sont jamais ressortis. Le Fichier central avait pour dernier souci de rédiger des actes de procédure et d’envoyer les « suspects » devant un juge. Lorsqu’il avait été livré à Simbikangwa, le « suspect » ne pouvait pas rentrer à pied chez lui. On lui avait attaché les pieds et le capitaine, s’approchant avec sa chaise roulante, lui assénait des coups de barre de fer sur les orteils. Ca rendait la marche difficile pendant un certain temps. Cette espèce de danse sadique du paraplégique avait frappé les esprits à Kigali. Quand on croisait le capitaine Simbikangwa , on baissait les yeux, pour ne pas se faire remarquer.
Pour le capitaine, c’était encore la belle vie. Le gouvernement lui avait concédé une grande villa « de fonction » dans le quartier le plus huppé de Kigali, le « Kiyovu des riches ». Le capitaine Simbikangwa était lui-même riche. Le président de la cour d’assisses de Paris détaille son patrimoine. De beaux pick up automatiques que le capitaine pouvait conduire lui-même : « 4X4 Pajero noire, puis un Toyota, puis une Pajero blanche ». Un ranch avec une soixantaine de vaches laitières du côté de Gisenyi, au nord-ouest du Rwanda, et à Kigali, au moins deux villas, sinon trois, louées à des Occidentaux. Le président suppose en passant que tout ça avait été payé par l’assurance, après l’accident. Une supposition bienveillante…
« Moi, faire partie de l’Akazu ? Je dois dire que c’est faux »
Le matin, il avait « résumé » l’histoire du Rwanda, pour que les jurés comprennent le contexte de ce procès historique, le premier d’un génocidaire présumé en France. On voyait presque les mots danser dans la tête des jurés : Akazu, projet Gebeka, la Synagogue… Il leur faudra du temps pour comprendre la charge cachée de ces mots exotiques. « La Synagogue » était le surnom de la plus belle villa du capitaine Simbikangwa, dans le quartier Remera. C’est à la « Synagogue » que se tenaient les réunions « au sommet » de la préparation du génocide, selon un repenti, Janvier Afrika. On y voyait parfois Juvénal Habyarimana et son épouse Agathe participer aux réunions, toujours selon Janvier Afrika. Recevoir ces sommités montait que le capitaine Pascal Simbikangwa n’était pas n’importe qui, malgré son infirmité. Il appartenait à l’Akazu « la petite maison », un terme qui désignait depuis l’époque monarchique le noyau dur du pouvoir, ceux qui contrôlaient le pays et s’enrichissaient outre mesure.
« L’Akazu » ? Dans son étroit box vitré, Pascal Simbikangwa fait rouler son fauteuil roulant près du micro pour dire qu’il ne comprend pas bien ce terme. Il détache ses mots. « Moi, faire partie de l’Akazu ? Je dois dire que c’est faux ». Pour lui, finalement, « Akazu » ne veut pas dire grand chose, de toute façon il n’en faisait pas partie. Alors…
Le président aimerait bien le prendre en défaut, dès la première journée d’audience, pour que le processus judiciaire se déroule sans anicroche. Lors de son premier interrogatoire, à Mayotte, où il avait été arrêté malgré sa fausse identité, Simbikangwa expliqua son infirmité : son véhicule avait sauté sur une mine. Une vantardise ridicule car la guerre civile éclata quatre ans après l’accident. L’accusé élude. Parle de la guerre, des visées du FPR. Là, son discours est bien rôdé : « On ne fait pas une guérilla dans un pays à majorité hostile. Vous pouvez demander à Reporters sans Frontières… j’ai dit la même chose, à l’époque. L’accord de paix était mal fait… ».
Fausses identités
Le président et les avocats des parties civiles reviennent longuement sur les différentes identités du capitaine. Il avait tenté d’obtenir l’asile politique à Mayotte sous un faux nom. « On » lui avait dit de cacher le fait qu’il avait été un dignitaire du régime Habyarimana. Les fausses identités ont fini par perdre le capitaine, car son petit trafic a ému les autorités de l’île de Mayotte, bien plus que les soupçons de complicité de génocide. Mais il a réponse à tout. Ce sont simplement ses différents noms, car au Rwanda, prétend-il, il n’y a pas d’état civil. Si on l’en croit, Pascal Simbikangwa, le nom qu’on lui connaît, celui qui s’étale dans les livres sur le génocide, n’est pas le vrai nom. Il faut lui reconnaître sur ce point une certaine constance, car depuis son arrestation il a répété tout et son contraire sur ses différents noms, sur ses « enfants », etc. On finit par comprendre qu’il n’est pas l’homme seul qu’il prétend. Il a de la famille en France, notamment un frère qui habite à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines.
Bien calé dans son fauteuil, veste en cuir crème bien coupée, le regard aux aguets, Pascal Simbikangwa ne laisse rien passer qui pourrait le mettre en difficulté. Sauf sa nostalgie : « En tant que militaire, j’étais une autorité dans le pays. J’étais directeur d’administration centrale ». Comme l’a écrit quelqu’un, le Rwanda, c’est à 7 000 kilomètres, le génocide, les jurés ne comprendront pas…
Jean-François DUPAQUIER
Plus d’information sur le site : www.proces-genocide-rwanda.fr
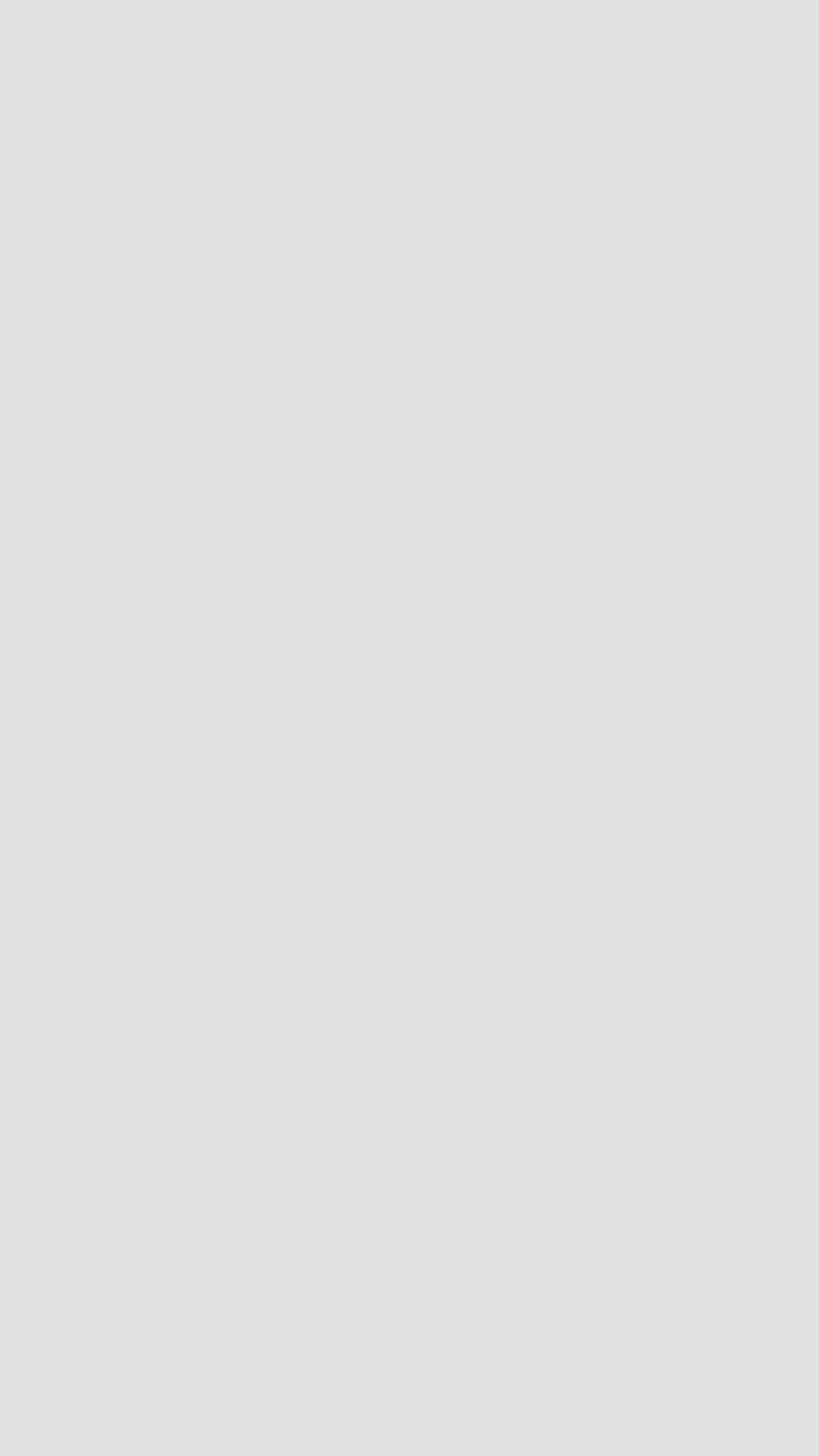


 envoi en cours...
envoi en cours...

















