En juin 1994 au Rwanda, l’armée française avait pour mission moins d’arrêter le génocide des Tutsi que de stopper l’avancée du FPR. Guillaume Ancel était capitaine dans l’armée française, chargé de guider les frappes aériennes lorsqu’il fut envoyé au Rwanda dans le cadre de l’opération Turquoise. Son témoignage, de terrain, est dévastateur pour la thèse avancée par Paris d’une opération d’abord « humanitaire ».
L’histoire officielle est belle : alors que depuis trois mois la communauté internationale observait sans réagir le génocide des Tutsi du Rwanda, la France « pays-des-droits-de-l’homme » voulait montrer l’exemple. Elle enverrait dans l’urgence ses Forces spéciales pour arrêter l’horreur, pour stopper les génocidaires.
Mais l’histoire officielle est un conte à dormir debout. Vingt-et-un ans plus tard, la spectaculaire intervention « militaro-humanitaire » Turquoise au Rwanda suscite toujours plus de questions et d’accusations. S’agissait-il vraiment de sauver huit à dix mille survivants tutsi de l’est du Rwanda alors que depuis le 6 avril, plus de huit cent mille avaient été exterminés sans que l’Elysée s’en émeuve vraiment ? Cette gesticulation militaire n’était-elle pas d’abord destinée à occulter l’aveuglement de l’Elysée (de 1990 à 1993, le régime du général Habyarimanana ne survécut que grâce à la présence des militaires français, ce qui lui laissa le temps de préparer le génocide des Tutsi) ?
Environ 2 000 rescapés le 27 juin…
Guillaume Ancel était officier , spécialiste du guidage des frappes aériennes. En juin 1994, dès le lancement de l’opération « Turquoise », il est détaché au 2e Régiment étranger d’infanterie (REI), une unité d’élite de l’armée française. Le 28 juin, il se trouve en face du poste de commandement (PC) des forces spéciales, sur le tarmac de Bukavu, au Zaïre (actuelle RDC), à la frontière du Rwanda. Il ne sait rien de Bisesero, une succession de collines boisées, où quelque 50 000 Tutsis ont cru trouver refuge depuis la mi-avril pour échapper au génocide. Isolés, ils résistent secrètement aux tueurs avec des armes traditionnelles, des pierres… Jour après jour leur nombre s’amenuise. Il reste environ 2000 rescapés le 27 juin, lorsqu’une petite équipe de militaires français conduite par le lieutenant-colonel Jean-Rémy Duval les découvre par hasard. Duval n’a pas suffisamment d’hommes pour les sécuriser. Il rend compte à l’état major : « Nous avons rencontré une centaine de Tutsi… Ils seraient 2 000 cachés dans les bois… Ils sont dans un état de dénuement nutritionnel, sanitaire et médical extrême… Ils espéraient notre protection immédiate. »
Duval promet aux rescapés que les Français reviendront au plus vite . Il ne doute pas que l’état-major va envoyer des renforts
… la moitié tués dans les trois jours suivants !
Pourtant, l’état-major de Turquoise fait comme si ce rapport n’avait jamais existé, pas davantage que les articles des journalistes présents à Bisesero, qui s’étalent dans la presse parisienne dès le 28 juin. Trois jours plus tard, le 30 juin, des sous-officiers français et des journalistes feignent de s’égarer à Bisesero pour y attirer le détachement du COS du capitaine de frégate Marin Gillier, qui vient de contourner la zone. Entretemps, environ mille rescapés ont été exterminés. Marin Gillier redécouvre ainsi « par hasard » Bisesero et son charnier de dizaines de milliers de cadavres. Cette fois, les journalistes français pullulent autour du charnier et des derniers rescapés. Le Commandement des opérations spéciales (COS) de Turquoise ne peut plus fermer les yeux sur ce haut-lieu du génocide des Tutsi. Les survivants sont enfin soignés et exfiltrés ce 30 juin. Trois journées perdues et beaucoup trop de « hasards »…
Une série de plaintes pour complicité de génocide a été déposée en 2005 par des rescapés des massacres de Bisesero. Le général Jean-Claude Lafourcade, qui commandait Turquoise a été entendu en janvier 2016 par le juge d’instruction Claude Choquet, du pôle génocide au TGI de Paris. Le dossier s’étoffe. Lafourcade a dorénavant le statut de témoin assisté. Tout comme son adjoint de l’époque le colonel Rosier (aujourd’hui général), qui commandait les forces spéciales, et qui a été entendu en décembre 2015.
Rosier et Lafourcade ont longtemps prétendu que le lieutenant-colonel Jean-Rémy Duval n’avait pas rendu compte de sa découverte des rescapés tutsi de Bisesero le 27 juin. Sans vergogne, les deux généraux ont accablé Duval. Or le juge d’instruction dispose aujourd’hui de preuves accablantes du contraire. Lafourcade et Rosier ont changé leur système de défense : oui, ils étaient informés, mais ils ne disposaient pas d’effectifs suffisants pour aller reconnaître et sécuriser la zone de Bisesero, le 28 juin et les jours suivants. AFRIKARABIA a interrogé l’ex-lieutenant colonel Guillaume Ancel sur ces dernières péripéties.
– A votre avis, l’argument dorénavant avancé par le général Lafourcade et son adjoint de l’époque, l’actuel général Rosier, du manque d’effectifs pour secourir les rescapés est-il recevable ?
Guillaume ANCEL : – C’est aussi faux que leur système de défense précédent, car l’opération « Turquoise » comptait déjà plusieurs unités opérationnelles, et notamment une compagnie de combat du 2° REI dans laquelle j’étais détaché pour guider les frappes aériennes. Cette unité de 160 légionnaires aguerris, bien équipés et très entraînés, était parfaitement adaptée à la sécurisation d’une zone de refuge pour des rescapés et aucun milicien ou soldat dépenaillé du régime en déroute n’aurait osé s’y frotter.
– MM. Lafourcade et Rosier auraient-ils pu oublier l’existence de cette unité ?
– La compagnie de combat du 2° REI était distante d’au moins… 50 mètres du poste de commandement des forces spéciales du colonel Rosier, puisqu’elle était stationnée sur le même petit aéroport de Bukavu, en République démocratique du Congo – à l’époque Zaïre -, depuis le 28 juin. Nous disposions de tous les véhicules adaptés à ce type de mission et de la force nécessaire pour sécuriser une zone refuge importante, de jour comme de nuit.
– Pourquoi le Commandement des opérations spéciales n’a pas pris la décision de mobiliser la compagnie de combat du 2° REI, ce qui aurait été logique dans un opération « humanitaire » ?
– Pourquoi ? Parce que tels n’étaient pas les ordres, tellement différents de la mission humanitaire qui servait de camouflage à la phase initiale de l’opération « Turquoise » : combattre le FPR, ces soldats tutsi qui menaçaient le gouvernement rwandais, allié de la France, et qui, seuls, balayaient les génocidaires conduits par ce régime démentiel. Pourquoi une telle mission ? Parce que c’était la politique de la France depuis plusieurs années, qu’elle ne faisait l’objet d’aucun débat démocratique, comme l’essentiel des opérations en Françafrique, et qu’elle était la stratégie de nos décideurs politiques.
– Disposez-vous d’informations qui vous permettent d’étayer cette accusation ?
– Le 30 juin, tandis que les unités des forces spéciales du capitaine Marin Gillier recevaient enfin l’ordre de s’occuper des rescapés, la compagnie de combat du 2° REI a reçu pour mission de stopper le FPR par la force devant la forêt de Nyungwe, à quelques dizaines de kilomètres plus à l’est. C’était donc la mission principale à ce stade de l’opération.
– Le génocide des Tutsi en 1994 est une des tragédies les plus graves auxquelles la France est mêlée, parce que c’est un génocide, parce qu’il a fait près d’un million de victimes, parce que le rôle de la France reste masqué par des manoeuvres délétères depuis plus de 20 ans. Pensez-vous que l’Elysée était complice des génocidaires ?
– Je n’ose pas imaginer que la France ait participé mais j’ai peur que, par des décisions qui échappent gravement à tout contrôle démocratique même a posteriori, la France ait commis des actes qui peuvent être qualifiés juridiquement de complicité de génocide.
– Vous étiez sur le terrain, détaché dans une compagnie de combat de la Légion étrangère. Comment pouvez-vous faire le lien entre les actions que vous meniez et des décisions politiques auxquelles vous n’aviez pas accès ?
– Ce n’est pas la peine d’avoir fait Saint Cyr pour comprendre les liens entre ce que faisions sur le terrain et ce qui était du strict ressort du pouvoir politique.
Je prends l’exemple de Bisesero : il est très probable que le colonel Rosier, qui commandait les unités des forces spéciales, ait donné l’ordre de ne pas retourner au secours des rescapés de Bisesero parce qu’il poursuivait une mission fixée par des décideurs politiques, une mission qui était de stopper les soldats du FPR, ceux qui pourtant balayaient les génocidaires. Il assume la responsabilité de l’ordre donné et ne risque pas de se déjuger alors même que toutes les preuves le contredisent.
– Quel serait l’intérêt de Rosier de continuer à couvrir une décision politique dans une affaire où son honneur de militaire est engagé ?
– Je ne pense pas que ce soit intéressant de lui demander des comptes, car il a agi en professionnel même s’il a manqué de discernement – ce qui est toujours facile à dire vingt ans après les faits. Je crois pour ma part que la question clef est de savoir quelle mission le pouvoir politique lui avait fixée. Je pense que ces ordres venaient directement de l’Elysée même si le gouvernement de cohabitation de l’époque ne pouvait rien ignorer de cette mission qui n’avait d’humanitaire que la couleur.
– Comment pouvez vous porter une telle accusation contre l’Elysee et le gouvernement Balladur de l’époque ?
– À cause des ordres reçus : au moment des faits j’étais dans une compagnie de combat de la Légion qui aurait dû être engagée pour protéger les rescapés de Bisesero si la mission réelle avait été humanitaire. Bien au contraire, comme je vous l’ai dit, nous avons été missionnés …pour aller stopper le FPR.
Dans le cadre de cette mission purement militaire, c’est moi qui devait guider les frappes aériennes, les bombardements par nos avions de chasse contre les colonnes du FPR. Cette mission n’a été annulée qu’au dernier moment le 1er juillet à l’aube alors que les avions étaient déjà en vol et attendaient mon guidage pour frapper.
– Quel rapport entre ces frappes aériennes annulées et l’affaire de Bisesero ?
– Il s’avère que le PC qui a annulé la mission était justement le PC JUPITER, celui qui est sous l’Elysée. C’était donc une décision du plus haut niveau politique en France, une décision de la présidence de la République.
– Comment le savez-vous ?
– Le pilote de chasse qui a reçu l’ordre d’annuler sa mission, alors qu’elle était déjà lancée, et de faire demi-tour avec son chargement de roquettes, n’en a pas cru ses oreilles et a demandé une confirmation. Le contrôleur aérien lui a alors annoncé que cet ordre venait directement du PC Jupiter (situé à l’Elysée) et qu’il n’y avait pas de doute possible. Ce pilote me l’a expliqué par la suite, puisque je devais guider cette patrouille qui était déjà en vol à proximité de la frontière entre le Zaïre et le Rwanda. Sa surprise a été d’autant plus grande que nous ne sommes pas censés être en contact avec ce PC. Son témoignage est crucial et aussi peu contestable que le mien, car ce sont des faits vécus, pas des histoires reconstruites par des état-major forcément aux ordres.
– Vous voulez dire que le président Mitterrand ordonnait lui même cette opération de bombardement du FPR ?
– Je n’étais pas à l’Elysée, mais je n’ignore pas que le président Mitterrand était très affaibli par sa longue maladie. Seul un proche du Président qui avait toute sa confiance pouvait donner un tel ordre.
– Hubert Védrine était alors une sorte de « président-bis », dans l’ombre de François Mitterrand… Lui ou un autre, c’était bien l’Elysée qui pilotait une opération de soutien du gouvernement génocidaire sous couvert d’une mission humanitaire ?
– Oui bien sûr, mais n’imaginez pas deux secondes qu’une telle opération ait pu être préparée et conduite sans que le gouvernement Balladur en soit informé. Faire décoller des patrouilles de chasseurs avec le soutien nécessaire pour une opération de guerre, engager des unités à terre contre un ennemi bien entraîné avec des combats violents aux dommages évidents ne peut se faire sans une mobilisation des moyens de la défense, une information du premier ministre, du ministre de la Défense et de celui des Affaires étrangères.
– Pourquoi auraient-ils d’abord ordonné cette mission pour se rétracter au dernier moment, au petit matin du 1er juillet ?
– Vraisemblablement à cause de l’affaire de Bisesero, qui a dû provoquer un débat polémique à l’Elysée au cours des heures suivantes, dans la nuit du 30 juin au 1° juillet : les rescapés de Bisesero sont enfin secourus le 30 juin, les images de Bisesero passent au « 20 heures », le génocide des Tutsi est dorénavant un fait avéré.. Les nombreux journalistes sur place peuvent témoigner de l’orientation réelle de cette opération « humanitaire ».
L’Elysée a pu prendre conscience brutalement qu’il n’est plus possible de poursuivre une opération « secrète » de combat contre le FPR sans risquer que la France soit mise au ban des nations pour « complicité de génocide ». Le débat aurait été suffisamment âpre pour durer une partie de la nuit, et dans l’urgence un conseiller est descendu au PC JUPITER pour interrompre l’opération de bombardement que je devais guider.
– Ceci ouvre des questions sur l’agenda de l’Elysée : d’un côté, une opération « humanitaire » fortement médiatisée, de l’autre une opération militaire secrète contradictoire avec la précédente ?
– Cette opération était bien réelle, j’en ai été témoin et acteur. Est-il possible de cacher une telle opération ? Cela me semble impossible puisque les journalistes sur place réalisent avec Bisesero que l’opération Turquoise est, initialement, à double face. Impossible aussi d’effacer les archives car une opération aérienne nécessite un suivi technique et administratif qui laisse des traces dans de nombreux relevés.
Si des historiens avaient la garantie d’accéder réellement aux archives, il leur faudrait peu de temps pour reconstituer ces faits qui ne peuvent qu’interroger sur la responsabilité des décideurs politiques français de l’époque. Je comprends d’ailleurs pourquoi ces derniers dépensent autant d’énergie pour que tout cela reste enterré le plus longtemps possible.
– Pourtant, des officiers comme Hogard ou Lafourcade critiquent vertement vos témoignages ?
– Vous pouvez même dire qu’ils sont insultants, là où ils s’étaient contentés jusqu’ici de pertes sélectives de mémoire.
Jacques Hogard prend soin de défendre la version officielle à laquelle il a contribué et de s’exprimer sur un ton péremptoire face à un « jeune capitaine » –que je n’étais déjà plus – alors que nous sommes tous les deux civils depuis longtemps et que les années ont blanchi ce qui nous reste de cheveux. Peut être est-ce en relation avec la société « d’intelligence économique » qu’il dirige, – EPÉE – , dont le nom même interroge sur la nature des services qu’il vend depuis 15 ans ?
– Selon vous, le colonel Jacques Hogard est un témoin important ?
– Pendant l’affaire de Bisesero, il accompagnait le colonel Rosier le 30 juin et ce serait intéressant qu’il essaie de se rappeler devant le juge du pôle génocide ce qui s’est passé plutôt que ce qu’il prétend en penser.
Quant au général Lafourcade qui commandait l’opération Turquoise, même s’il avait la partie officielle de l’intervention humanitaire, il ne peut ignorer ce qui se faisait en parallèle sur le terrain. C’est tout à son honneur de défendre sa propre responsabilité, mais il devrait laisser les décideurs politiques de l’époque s’expliquer sur leurs décisions, c’est là que le débat démocratique sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis fait défaut.
– Subissez-vous des pressions ?
– Des pressions en tout genre et assez désagréables, à la hauteur de la gravité du sujet. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais je ne céderai pas à ces pressions pour me faire taire tant que ce débat ne se tiendra pas publiquement et que nous puissions enfin connaître la vérité du rôle de la France dans le dernier génocide du XXe siècle.
– Comprenez-vous l’obstination des officiers français de Turquoise devant le juge d’instruction ?
– L’armée française intervient militairement en 1994 dans l’opération Turquoise qui se veut humanitaire. Mais cette intervention conjuguait en réalité deux opérations à la frontière desquelles je me suis trouvé en permanence : d’un côté une opération humanitaire de protection des rescapés à laquelle nous étions fiers de participer avec des soldats d’élite, alors qu’en parallèle nous menions aussi des actions destinées clairement à défendre un gouvernement qui organisait le génocide. Nous avons essayé de protéger ce gouvernement criminel, en nous opposant à ses ennemis, les soldats du FPR, quitte à abandonner à leur sort des rescapés comme ceux de Bisesero qui espéraient pourtant être sauvés par l’opération Turquoise. Puis nous avons protégé la fuite des génocidaires vers le Zaïre, avant de les réarmer dans des camps de réfugiés. Difficile de ne pas être effrayé par ce que cela signifie en termes de responsabilité…
– Cela rend-il vos compagnons d’armes complices du génocide des Tutsi ?
– Nous aurions pu combattre les génocidaires, mais nous nous sommes opposés jusqu’au bout à ceux qui les affrontaient, obsédés par un héritage politique dénué de sens, les stopper à tous prix. Nous n’avons pas tiré les leçons du fait que nos alliés d’hier étaient les génocidaires de cette situation odieuse.
Cela rend-il mes compagnons d’armes complices du génocide des Tutsis ? Ma conviction est que ce n’est pas à eux qu’il faut demander des comptes, mais aux décideurs politiques de l’époque qui continuent à fuir leur responsabilité pour des erreurs dramatiques qui se sont soldées par plus de 800 000 personnes massacrées, et tant de souffrances pour les rescapés.
Propos recueillis par Jean-François DUPAQUIER
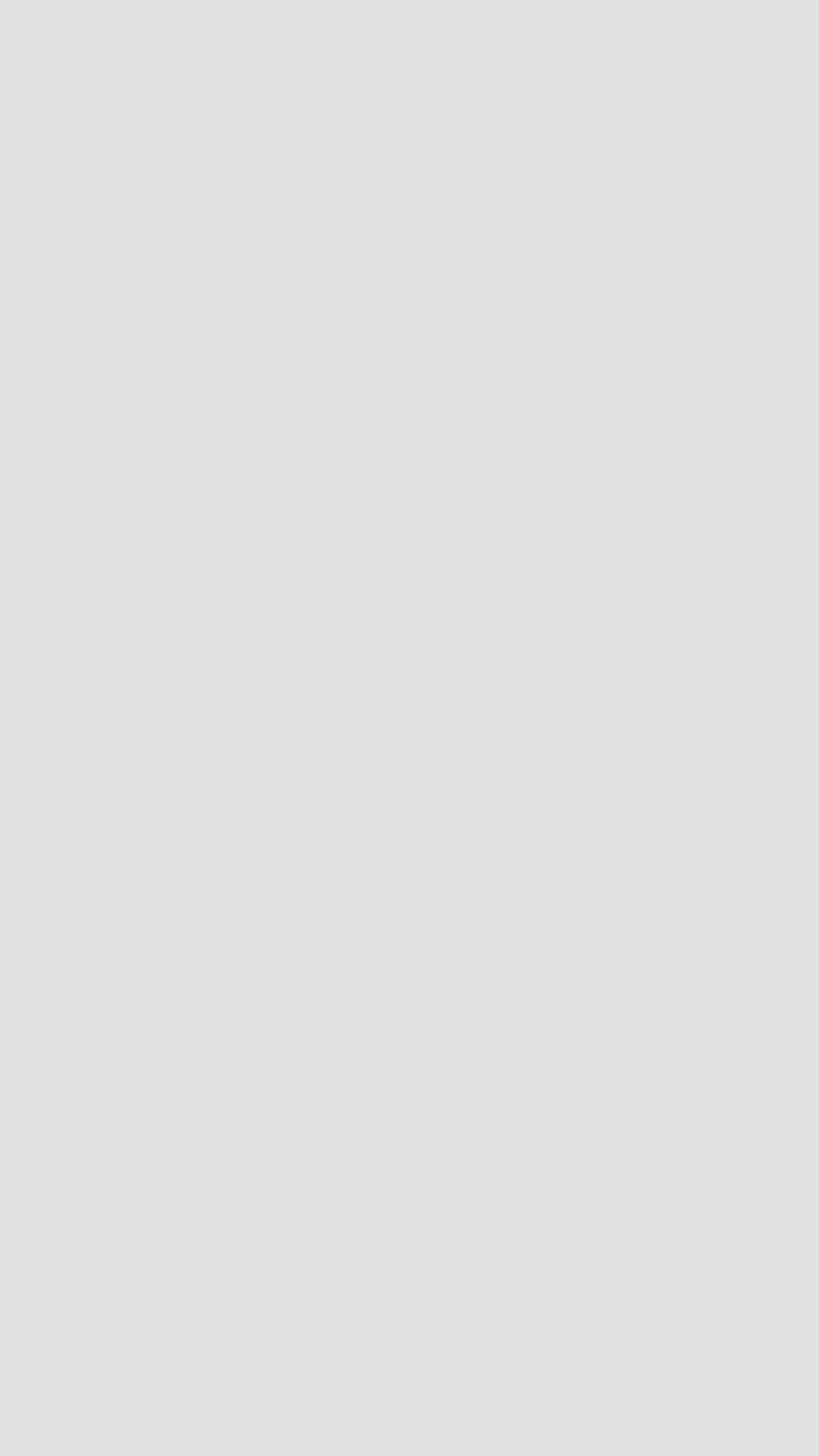


 envoi en cours...
envoi en cours...


















Pingback: Rwanda : un officier français témoigne du rôle trouble de l’opération Turquoise | Le Colonel 2.0