La pratique des enlèvements se généralise à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). Une récente étude de Global Initiative Against Transnational Organized Crime vient d’analyser ce phénomène en pleine expansion, « qui n’est pas seulement l’oeuvre des groupes armés, n’épargne aucune couche sociale et est devenue une forme ordinaire de délinquance ».

La recrudescence des enlèvements devient inquiétante en République démocratique du Congo (RDC). Si les cas de kidnapping sont récurrents dans l’Est du pays, où sévissent encore plus de 120 groupes armés, le phénomène gagne désormais d’autres provinces, mais aussi la capitale, Kinshasa, en proie à une forte hausse de la criminalité. Début juillet, la police de Kinshasa a présenté au ministre de l’Intérieur 27 personnes suspectées de kidnapping. Dans le territoire de Beni, la société civile a dénombré plus de 3.000 enlèvements mettant en cause depuis plusieurs années les rebelles des ADF. Trois chercheurs viennent récemment de se pencher sur l’économie de ce juteux business pour le réseau Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Justin Mwetaminwa, Marc-André Lagrange et Thierry Vircoulon ont réalisé une étude – accessible ici – qui retrace « la généalogie de cette pratique criminelle et montre comment le contexte politique incertain des années 2016-2018 a contribué à amplifier ce phénomène ». Un business qui s’avère révélateur de « la criminalisation des services de sécurité » congolais et qui souligne qu’une partie de la population s’adonne désormais à cette pratique « dans une logique de survie ».
Le kidnapping n’est plus réservé aux étrangers
Les trois chercheurs notent tout d’abord que cette forme de criminalité s’est fortement développée dans les zones de conflits, au Nord et Sud-Kivu ces sept dernières années. Ils distinguent le kidnapping, avec demande de rançon, à l’enlèvement, utilisé par les groupes armés pour recruter par la force des jeunes hommes ou des enfants pour devenir miliciens. Ironie du sort, « depuis l’annonce du programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement communautaire et Stabilisation (P-DDRCS) le 5 juillet 2021, on assiste à une recrudescence des enlèvements de jeunes par les groupes armés du Nord-Kivu, qui cherchent à gonfler le nombre de leurs troupes », révèle l’étude. La pratique du kidnapping avec rançon a également évolué, et n’est plus réservée aux seuls étrangers travaillant pour des entreprises internationales, des ONG, ou aux touristes du parc des Virunga. Le kidnapping touche désormais toute la population.
Un sous-produit du conflit entre le M23 et l’armée
L’étude de Global Initiative Against Transnational Organized Crime revient également sur les différentes étapes du phénomène des enlèvements. A partir de 2012, « la pratique du kidnapping s’est imposée », expliquent les chercheurs. « En représailles contre la rébellion du M23, l’armée et ses (milices, ndlr) alliés ont lancé une campagne de kidnappings contre les notables locaux favorables à la rébellion ». Les enlèvements se généralisent alors dans le territoire de Rutshuru, et sont principalement le fait des groupes armés. « À partir de 2015, le territoire de Rutshuru est devenu le haut-lieu du kidnapping au Nord-Kivu. Le kidnapping est donc un sous-produit du conflit entre le M23 et l’armée congolaise ».
Une tactique répressive du régime Kabila
Une nouvelle phase de cette pratique intervient avec la crise politique et électorale de 2016-2018, lorsque Joseph Kabila cherche à s’accrocher à son fauteuil présidentiel. Les kidnapping n’épargnent aucun groupe social et visent essentiellement les opposants au régime Kabila. « Goma et Bukavu étaient alors considérées comme des villes hostiles au gouvernement ». Les enfants, « cible facile » sont particulièrement touchés par le phénomène. « Certains otages étaient torturés et parfois assassinés, même après le paiement des rançons, expliquent les chercheurs. Cette brutalité (…) a été perçue localement comme une tactique répressive du régime directement liée à la crise politique ». A l’origine de nombreux kidnapping, on retrouve des gangs ou des milices « financés par des acteurs politiques ». La pratique de l’enlèvement s’est tellement banalisée « que de faux kidnappings sont parfois organisés. Des étudiants ont ainsi extorqué de l’argent à leurs familles (…) et des employés d’ONG ont fait de même au détriment de leurs employeurs ».
Les ravisseurs sont aussi des citoyens ordinaires
Le mode opératoire pour réclamer la rançon est très souvent identique. « Les otages sont retenus pendant des périodes allant de quelques heures à un mois. Les ravisseurs appellent les familles des otages au téléphone pour exiger des rançons qui varient entre 200 et 2.500 $ pour les villageois ou les petits commerçants, et entre 500 et 5.000 $ pour les employés congolais des ONG internationales ». L’étude révèle le rôle prépondérant des téléphones portables pour contacter les proches « mais aussi pour faciliter les transferts d’argent (…) via des plateformes de paiement mobile ». Les témoignages recueillis notent également que les kidnapping « ont tendance à augmenter avant les fêtes de fin d’année et avant la rentrée scolaire, des périodes où le besoin d’argent se fait sentir », preuve que « les ravisseurs sont plutôt des citoyens ordinaires » qui participent à des fêtes traditionnelles et ont des enfants scolarisés.
Police et armée complices, justice absente
Ce qui explique l’augmentation constante des enlèvements, c’est la totale impunité dont jouissent les kidnappeurs. « Dans le cas des kidnappings d’enfants, la police nationale congolaise encourage généralement les familles à payer des rançons », révèle l’enquête. La justice est également aux abonnés absents dans les affaires d’enlèvements. En 2021, 20 cas ont été jugés au Sud-Kivu, alors que 60 kidnapping ont eu lieu pendant le seul mois de juillet et uniquement sur le territoire d’Uvira. Pire, il existe des complicités avérées entre les services de sécurité et les criminels. « Sur l’axe menant du parc de Kahuzi-Biega à Bunyakiri (Sud-Kivu), beaucoup s’interrogent sur la facilité avec laquelle les kidnappings ont lieu à proximité d’installations militaires ». Idem sur l’axe Goma-Rutshuru, où « de nombreuses sources estiment que, sur cet axe, les kidnappings sont coorganisés par les militaires, les gangs et les groupes armés ».
Pour un Etat efficient
Pour lutter contre les kidnapping qui tendent à devenir une pratique endémique de l’Est de la RDC, mais qui s’exporte aussi vers les autres provinces, l’étude de Global Initiative Against Transnational Organized Crime prône « une rotation régulière des unités militaires dans les Kivus, des formations anti-kidnapping pour les groupes particulièrement ciblés », mais surtout la coopération des compagnies de téléphonie mobile qui devraient collaborer avec la police et la justice afin de limiter le paiement des rançons. Ce très instructif état des lieux rappelle, s’il était encore nécessaire de la faire, qu’une réforme en profondeur du système de sécurité, de la justice s’avère plus que jamais indispensable… au risque de voir se développer de nouvelles formes de criminalité.
Christophe Rigaud – Afrikarabia
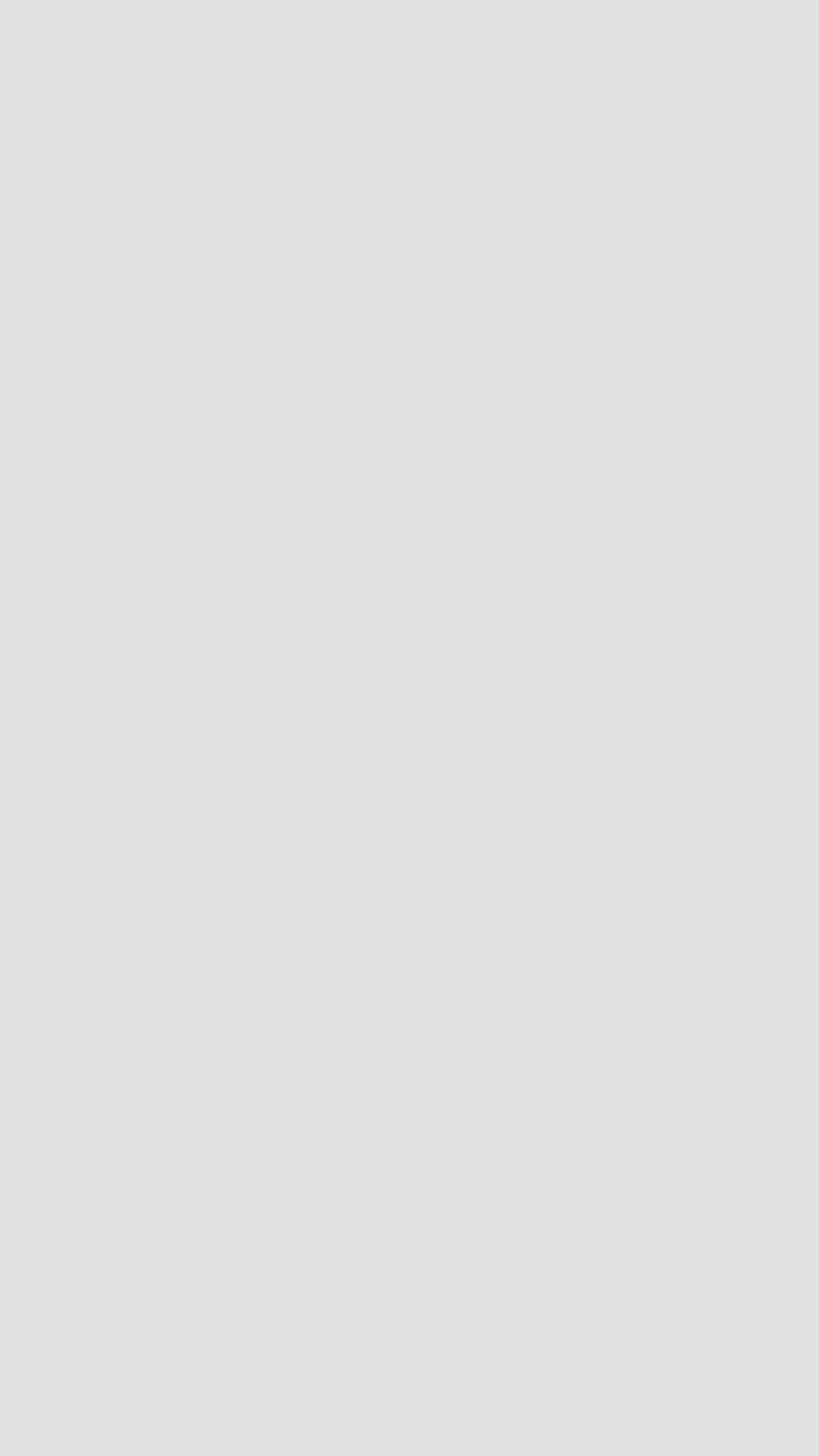

 envoi en cours...
envoi en cours...


















Le pays est pourri à la manière de ses dirigeants.
C’est étrange que les auteurs du rapport blâment les téléphones portables. Pourquoi cela n’arrive sous d’autre Cieux?
Bientôt nous allons blâmer le Rwanda pour ce banditisme?
Au secours la SADC!!!
J’ai honte de ce pays.
Pourquoi ce phénomène ne se passe pas sous d’autres cieux ? Le mot kidnapping est il d’origine congolaise ? Etes vous sous informé ou pas ? Bizarre.N’avez vous pas en mémoire ces detournements d’avions , l’affaire Lindbergh,action directe , ETA, la bande à Baader ? Etc…. Ces pratiques dans mon pays seront eradiquees puisqu’elles n’ont comme but sa destabilisation….
Désolé, la RDC est un paradis! Avec 250 groupes armés sur un territoire dont les dirigeants pleurent devant qui veut les entendre que le mal c’est le Rwanda; pays 80 fois plus petit et don’t la population est 10 fois moins.
Mais la RDC est riche pour les autres et pauvres pour ses citoyens!!!
Bon courage
Pas la peine de convoquer le Rwanda ou un autre bouc-émissaire, le kidnapping devenu une pratique endémique à l’Est de la RDC s’exportant vers les autres provinces est un autre signe d’un Etat Congolais quasi inexistant où la criminalité prospère sur manque du respect de lois et de moyens de subistance adaptés. Qu’elle touche les institutions comme l’armée et la police et soit présente dans tous les secteurs de la vie quotidienne.est.une.calamite pour notre pays où un.Etat efficient qui protège ses Citoyens, leurs biens et favorise l’acquisition de leurs moyens.de subsistance quotidiens
risque de ne pas venir de si tôt.