Les atteintes aux journalistes et aux médias se sont accrues en 2020 selon le dernier rapport de Journalistes en Danger (JED). En cause : les tensions politiques et « le retour des prédateurs », dénonce l’ONG.

Comme pour souligner l’urgence de la nécessaire amélioration de la liberté de la presse en République démocratique du Congo (RDC), les services de sécurité de la Présidence de la République congolaise viennent d’en offrir ce mardi un parfait exemple. Deux journalistes de « Bosolo Na Politik » ont été interpellés dans l’enceinte même du Palais de Nation où le président Félix Tshisekedi vient de lancer ses consultations nationales.
En cause, une vidéo tournée par ces journalistes où l’on voit plusieurs collaborateurs du chef de l’Etat rester ostensiblement assis alors que Félix Tshisekedi venait de faire son entrée dans la salle. Un couac qui a fait rapidement le tour des réseaux sociaux… mais qui n’a visiblement pas plu à la Présidence. Les deux journalistes ont été libérés après 24 heures de détention par l’Agence nationale de renseignements (ANR).
Des atteintes à la liberté de la presse en hausse
Au-delà de cet épisode anecdotique, l’état de la presse en RDC semble se dégrader en 2020 selon le rapport de Journalistes en Danger (JED). L’ONG a enregistré au moins 116 cas d’attaques et d’atteintes diverses contre les journalistes et les médias. Un journaliste a été tué, un autre est porté disparu, 9 autres ont été incarcérés plus de 48 heures et 31 interpellés. 15 journalistes ont été menacés ou harcelés, 31 agressés ou torturés et Journalistes en Danger a relevé 27 cas de censures ou d’entraves à la libre circulation.
« Une banalisation des attaques contre les médias »
Un triste bilan alors que l’année 2019 avait connu une certaine embellie avec l’arrivée à la présidence de Félix Tshisekedi et seulement 85 cas d’atteintes aux journalistes recensés. Pour Tshivis Tshivuadi, secrétaire général de JED, « au moins 4 facteurs de risque et qui menacent la liberté de la presse » au Congo : « le contexte du Covid-19, la banalisation des attaques contre les médias et un cadre juridique obsolète et liberticide ».
Une justice absente
L’impunité reste une des préoccupations principales de Journalistes en Danger. Le 2 novembre 2019, un journaliste a été assassiné en Ituri par les hommes armés à cause de « son implication dans la campagne de riposte contre l’épidémie d’Ebola ». « Aucune enquête n’a été ouverte pour retrouver les assassins de ce journaliste, alors que beaucoup d’autres journalistes ont reçu des menaces et des médias ont été contraints de cesser leurs activités, par peur des représailles » s’alarme JED.
Une loi sur la presse qui date de Mobutu
L’ONG plaide également pour une modernisation de la loi sur la liberté de la presse. « La RDC s’appuie encore sur une loi répressive du 22 juin 1996 » s’inquiète JED. Cette loi, adoptée sous la dictature du Maréchal Mobutu, fait référence au Code pénal qui prévoit la peine capitale pour des faits constitutifs « d’atteinte à la sureté nationale ». L’ONG demande aux autorités congolaises « de supprimer les peines d’emprisonnement des journalistes lorsqu’ils dénoncent des cas avérés de corruption ou de détournements ».
« Un triste retour de l’ANR »
Les principales agressions contre les journalistes sont le fait des forces de sécurité. Pourtant, l’arrivée à la présidence de l’opposant Félix Tshisekedi avait suscité, début 2019, un certain espoir pour les journalistes congolais. « Mais les engagements du président de la République d’initier des campagnes de sensibilisations des forces de sécurité au respect du travail des journalistes, n’a été suivi d’aucun acte concret » déplore Tshivis Tshivuadi. Pire, « La conséquence la plus visible de ce manque de volonté politique, c’est le retour en force de certains services tels que l’ANR de triste réputation, qui a refait surface et qui n’éprouve plus aucun complexe dans les interpellations intempestives, et les détentions arbitraires ».
Christophe RIGAUD – Afrikarabia
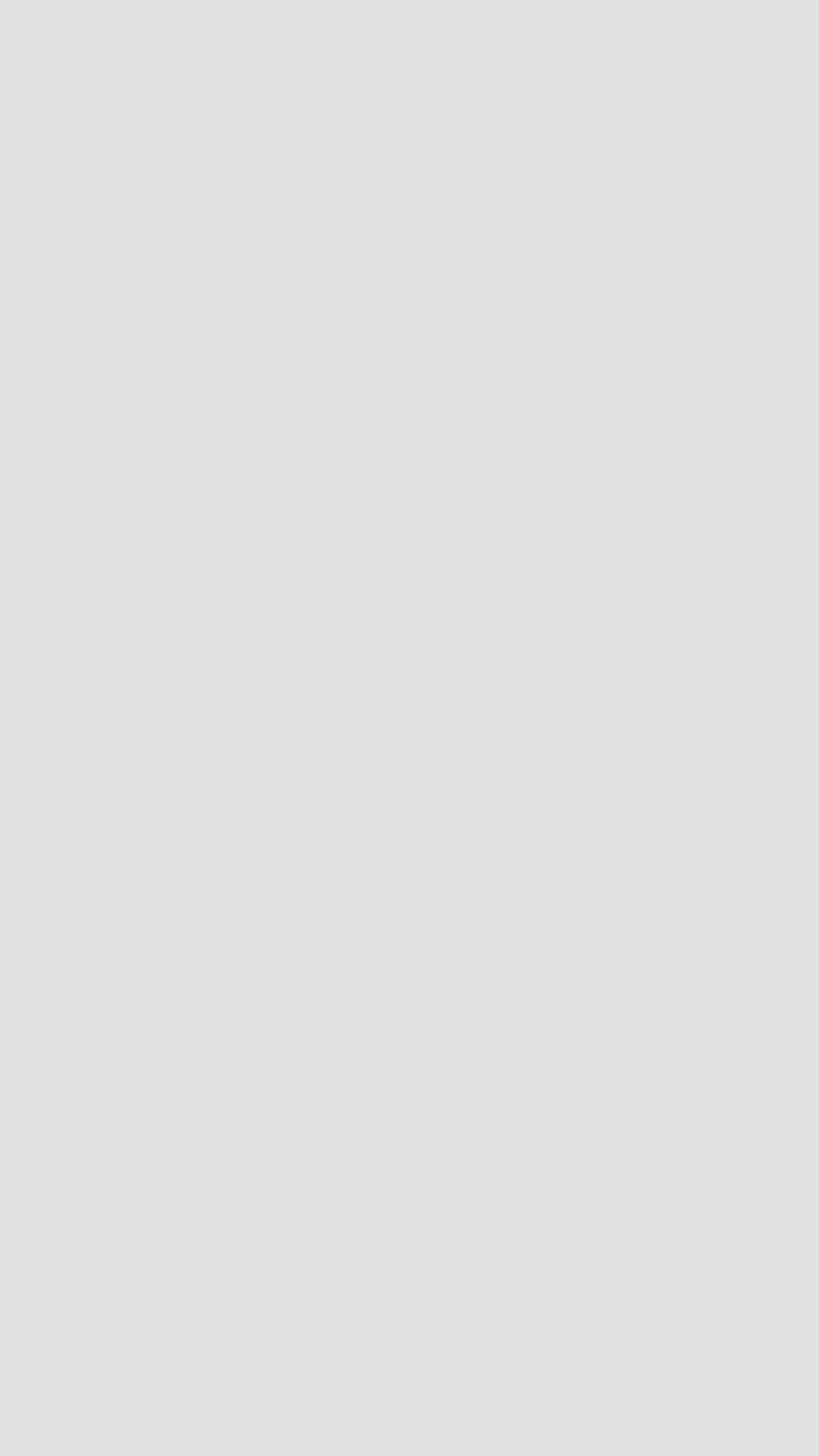

 envoi en cours...
envoi en cours...

















