L’afflux de migrants économiques au Katanga, venus des Kasaï, et l’arrivée du président kasaïen Félix Tshisekedi au pouvoir ravivent les tensions communautaires. Des mesures ont été récemment annoncées pour développer le Grand Kasaï, limiter les flux migratoires et la vieille rivalité entre le riche Katanga et sa voisine sous-développée.

Les relations entre les provinces des Kasaï et du Katanga n’ont jamais été un long fleuve tranquille. Le dernier épisode en date résume assez bien le sentiment anti-kasaïen toujours très présent au Katanga. La scène se passe à la télévision, au cours d’émission animée par Paulette Kimuntu. La journaliste reçoit la députée katumbiste Dominique Munongo Inamizi. Depuis plusieurs mois, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des migrants kasaïens en route vers le Katanga. Un exode économique qui inquiète dans la riche province minière. A la télévision, la députée du Lualaba ne masque pas son ressentiment. Selon elle, les Kasaïens, « ces gens qui mangent des chiens » et qui arrivent au Katanga, avec leurs coutumes, devraient « rester chez eux ! » Les propos choquent et réveillent le vieux conflit entre les natifs du Katanga et les immigrés, le plus souvent venus du Kasaï.
La chasse aux Luba sous Mobutu
L’antagonisme entre Katangais et Kasaïens remontent à la colonisation belge où de nombreux Luba du Kasaï viennent travailler dans les entreprises minières katangaises et les administrations sous tutelle belge. Le Katanga est l’une des zones minières les plus riches du continent, avec ses immenses réserves de cuivre et de cobalt. Une richesse qui a attiré toutes sortes de convoitises : économique… mais aussi politique. Et comme souvent, les politiciens ont rapidement instrumentalisé et manipulé ces tensions communautaires. Le point d’orgue dramatique du conflit entre Katangais et Kasaïens culmine en 1992 et 1993, où des milices katangaises organisent des « nettoyages ethniques ». Plus de 5.000 Luba sont ainsi tués et 100.000 sont obligés de fuir la région. A la tête de ces violences, les jeunes de l’Union des nationalistes et des fédéralistes du Congo (UNAFEC) de Gabriel Kyungu.
Les Kasaï, provinces rebelles sous Kabila
Depuis l’été 2020, le spectre d’un afflux massif de Kasaïens au Katanga ravive le vieux serpent de mer de la rivalité entre Luba et autochtones. Les Kasaïens sont accusés « de venir voler le travail » des locaux, mais aussi de vouloir déstabiliser les rapports de force politique de la région en siégeant dans les Assemblées provinciales. Sans remonter à l’époque du maréchal Mobutu, le Kasaï a toujours été un grand oublié de Kinshasa, sous Kabila père et fils. Le père est largement venu taper dans les caisses de la MIBA, la société d’exploitation du diamant installée à Mbuji-Mayi. Quant à Joseph, le fils, il a violemment réprimé la révolte des « Kamwina Nsapu » dans les Kasaï, qui contestaient le pouvoir central de Kinshasa. Selon l’Eglise catholique, plus de 3.000 personnes ont été tuées dans cette répression sanglante. Sous Joseph Kabila, le Katangais, les Kasaï ont souvent été présentés comme des provinces « rebelles », fief de l’opposant historique Etienne Tshisekedi, mort en 2017.
Un Kasaïen à la présidence
Début 2019, c’est le fils, Félix Tshisekedi, qui s’empare du fauteuil présidentiel après un étonnant « deal » avec Joseph Kabila, qui lui cède sa place en échange des pleins pouvoirs au Parlement et dans les Assemblées provinciales. Depuis, Félix Tshisekedi a renversé la vapeur et s’est emparé des principales institutions congolaises : Assemblée nationale, Sénat, Commission électorale, Cour constitutionnelle, Banque centrale… Les Kasaïens sont maintenant aux manettes à Kinshasa, ce qui inquiète les Katangais et semble donner des ailes aux Kasaïens. Mais la région manque de tout : accès à l’eau, à l’électricité, à la santé. Les infrastructures routières sont inexistantes et l’économie tourne au ralenti avec une MIBA qui peine toujours à se relancer.
Une région à l’abandon
Le président Félix Tshisekedi en a fait l’amère expérience lors de sa tournée dans ses fiefs début 2022. « La mauvaise gouvernance ainsi que le faible taux de réalisation des projets lancés en provinces a aussi retenu l’attention du Chef de l’Etat », note le communiqué de la présidence congolaise. « Mais où sont donc passés les 6 millions de dollars débloqués récemment par le gouvernement ? », s’était même étonné le président. A chaque meeting, Tshisekedi semblait découvrir l’extrême pauvreté de sa terre d’origine. Selon l’ONU, le Grand Kasaï est une des régions les plus touchées par la malnutrition au Congo.
Une table ronde pour développer les Kasaï
Face à une double problématique : abandon des Kasaï par l’Etat et risque de tensions communautaires avec l’afflux récent de Kasaïens au Katanga, le gouvernement congolais a décidé de lancer une table ronde à Lubumbashi pour apaiser les tensions et limiter les flux migratoires. Le 30 avril dernier, plusieurs mesures ont été annoncées à la clôture de la réunion. La principale idée coule de source : il faut développer les Kasaï pour éviter la migration économique. La table ronde prône la construction et la réhabilitation des infrastructures routières et ferroviaires, la création de coopératives agricoles, de mini barrages électriques, ou le lancement de nouveaux projets miniers. Concernant le financement, la table ronde prévoit d’utiliser la caisse de péréquation qui reverse une partie des recettes de l’Etat aux provinces. Le hic, c’est que la caisse fonctionne sur le principe d’équité entre les provinces. Certains se demandent pourquoi aider davantage les Kasaï plutôt que d’autres territoires ? En creux, il y a la question de savoir si le riche Grand Katanga peut financer le « pauvre » Grand Kasaï ? Reste donc à savoir si les promesses de financement seront tenues.
Une « feuille de route » qui fait débat
Une autre mesure de la table ronde fait également polémique. Elle prévoit la mise en place d’une « feuille de route » pour contrôler les déplacements des Kasaïens vers le Katanga. Une disposition « contraire à la Constitution et discriminatoire » selon l’avocat de Lubumbashi Hubert Tshiswaka Masoka. Pour ce défenseur des droits de l’homme, « si d’autres provinces ne prévoient pas de telles mesures, la population kasaïenne passera par ces régions, soit pour s’y établir, soit pour transiter, en route vers le Katanga. Ainsi, la feuille de route sera tout simplement irréaliste, à défaut de consacrer un Etat dans l’Etat ». Et de poser cette question : « Comment la police agirait, afin de distinguer des Kasaïens « nés de père et de mère » établis au Katanga, de ceux nés au Kasaï, sans provoquer des troubles sociaux ». Une mesure à haut risque, qui pourrait davantage souffler sur les braises des tensions que de les apaiser.
Christophe Rigaud – Afrikarabia
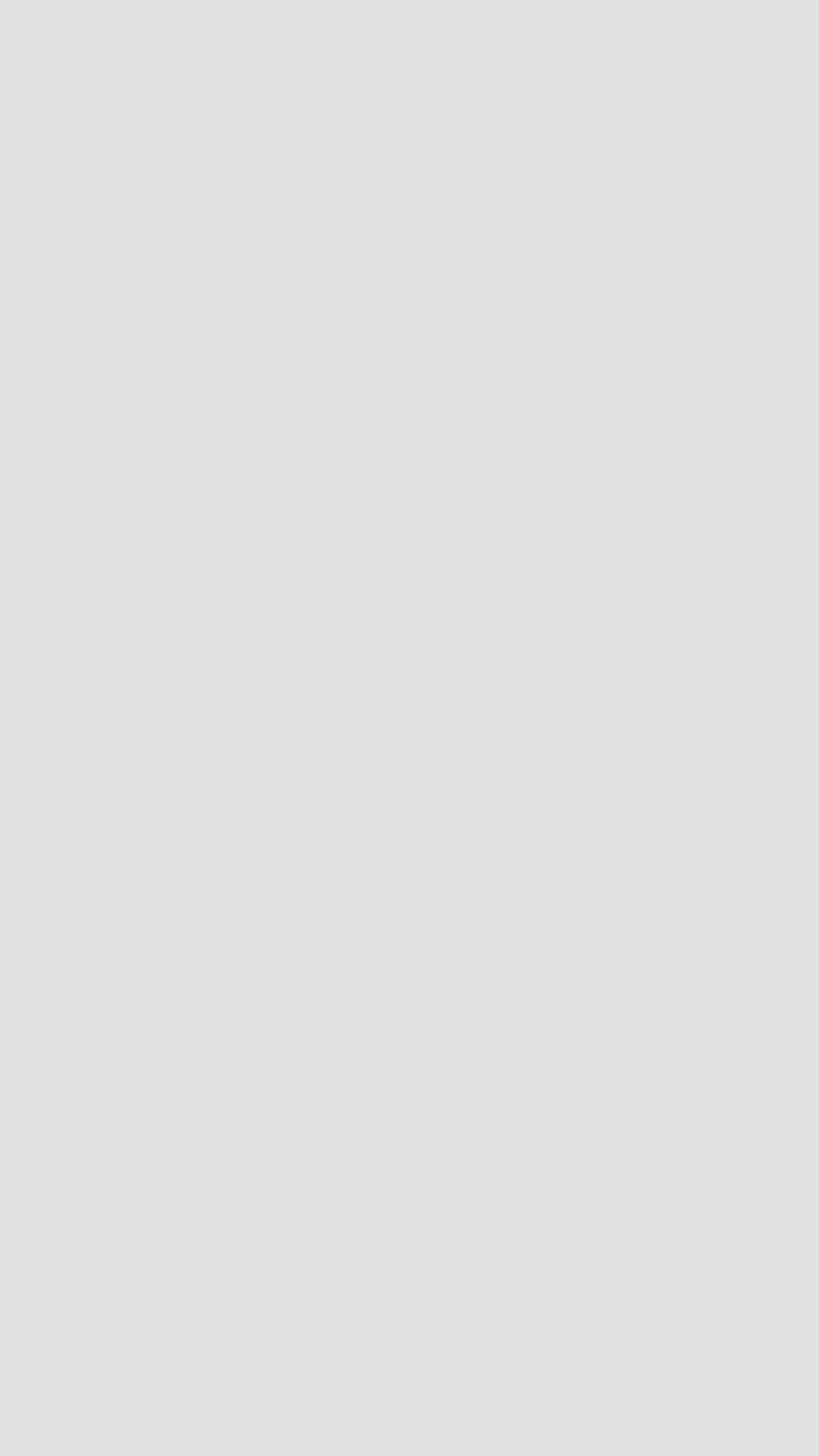

 envoi en cours...
envoi en cours...


















Le haut-katanga est aujourd’hui victime du surpeuplement, la ville de lubumbashi ne donne même pas l’aspet de la 2ème ville du pays, nous voulons est que tout deplacement de kasaï vers katanga soit bien justifier.