Le retour des rebelles du M23 et l’inefficacité de l’état de siège sur les autres groupes armés, signent l’échec de la lutte contre l’insécurité menée par le président Félix Tshisekedi. Pour les chercheurs Thierry Vircoulon et Marc-André Lagrange, « Le gouvernement Tshisekedi n’a fait que recycler des solutions inefficaces (…) identiques à celles apportées durant les mandats de Joseph Kabila ». Leur récent rapport, publié par l’Institut français de relations internationales (Ifri), explique cet échec par l’approche uniquement sécuritaire d’un problème de gouvernance.

Le dossier de l’insécurité à l’Est du Congo était en haut de la pile sur le bureau de Félix Tshisekedi à son arrivée à la présidence en 2019. La promesse de campagne du candidat Tshisekedi devenait alors l’un des principaux défis de son mandat à venir. Dans un récent rapport de l’Ifri, « République démocratique du Congo : à l’Est, rien de nouveau », Thierry Vircoulon et Marc-André Lagrange analysent la nouvelle approche du « problème de l’Est » par Félix Tshisekedi. Le nouveau président, « nommé » dans des conditions contestées, après un accord politique conclut avec Joseph Kabila, décide de « relancer la coopération sécuritaire avec les voisins ougandais et rwandais, de proposer un programme de démobilisation, désarmement et réinsertion (DDR) aux groupes armés, et de proclamer l’état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri le 3 mai 2021 ». Très vite, l’état de siège, qui confie le pouvoir civil aux militaires, s’avère être inefficace. La coopération militaire avec l’armée ougandaise, autorisée par Félix Tshisekedi à opérer sur le sol congolais pour éradiquer les Allied Democratic Forces (ADF), affiliée à l’Etat islamique (EI) est également un échec. Les opérations militaires ont pour seul résultat de disperser le groupe islamiste sur des territoires plus vastes. Dans la province de l’Ituri voisine, elle aussi sous état de siège, « les tueries à base ethnique se multiplient sous l’oeil impuissant des casques bleus ».
Les « fausses solutions » militaires
Les auteurs du rapport s’interrogent sur l’impasse dans laquelle se trouve la politique de pacification de l’Est « depuis le retrait des armées étrangères en 2003 et la mise en place d’un gouvernement élu en 2006 ». « L’absence de progrès dans la pacification de l’Est de la RDC résulte à la fois de la répétition des fausses solutions par les autorités congolaises et de la lassitude silencieuse mais profonde des acteurs internationaux ». Selon Thierry Vircoulon et Marc-André Lagrange, « le transfert de pouvoir de Kabila à Tshisekedi n’a pas modifié la donne sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud-Kivu et de l’Ituri ». Comme Joseph Kabila, Félix Tshisekedi est d’abord tenté par utiliser l’option militaire. L’ancien président avait lancé plusieurs campagnes militaires contre les groupes armés (Umoja Wetu et Kimia II en 2009, Amani Leo en 2010/12 et Sukola I et II en 2014/15). Pourtant, ces opérations n’ont jamais permis d’éradiquer durablement les groupes armés. Comme sous Joseph Kabila, les offensives lancées par Félix Tshisekedi sont restées sans résultat. Quant à la coopération sécuritaire régionale et à l’admission de la RDC au sein de l’East African Community (EAC), début de 2022, « elles ont toutes deux un air de déjà-vu » soulignent les deux chercheurs. Des opérations conjointes contre les ADF, avec l’Ouganda, et contre les FDLR, avec le Rwanda, durant le mandat de Joseph Kabila avaient déjà eu lieu, sans faire baisser l’insécurité dans la région.
« Le problème de l’Est est maintenant celui de l’EAC »
L’adhésion du Congo à l’EAC « ressemble à celle de la SADC en 1997. Il s’agissait alors pour Laurent-Désiré Kabila de trouver de nouveaux alliés pour contrebalancer la tutelle de ses alliés rwandais et ougandais ». Cette fois-ci, Kinshasa se tourne vers l’Afrique orientale « dans sa quête de solution sécuritaire ». « Avec l’entrée des troupes kényanes de l’EAC à Goma, le problème de l’Est congolais est maintenant devenu le problème des pays membres de l’East African Community et une question diplomatique entre Kinshasa, Nairobi, Kigali et Kampala. C’est entre ces quatre capitales que cela se joue maintenant » explique Thierry Vircoulon à Afrikarabia. La situation est également extrêmement confuse quant aux rôles de chacun des membres de l’EAC. « Les troupes kényanes ont pris pied à Goma. En même temps, l’Ouganda, qui soutient aussi le M23, mène des opérations conjointes avec l’armée congolaise contre les ADF, ce qui est une posture des plus étranges. Et puis, nous avons derrière le M23, le soutien de l’armée rwandaise ».
L’échec des programmes de démobilisation
L’échec de la pacification de l’Est congolais vient aussi de l’inefficacité des programmes de démobilisation, désarmement et réinsertion (DDR) des groupes armés. Le rapport de l’Ifri pointe les négociations ratées entre Kinshasa et les milices de la Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) et de la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO) en 2019 et 2020. Des engagements ont bien été signés avec les autorités congolaises, mais « aucun DDR ne s’est concrétisé (…) en raison du manque de fonds et des mauvaises conditions de vie accordées aux ex-combattants ». En 2021, le président Tshisekedi a lancé un nouveau programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS). Mais là encore, expliquent les chercheurs, « les leçons des échecs précédents ne semblent pas avoir été assimilées » : absence d’emplois pour la réintégration économique, détournement de fonds, absence de suivi du programme, intégration des anciens combattants dans des forces de sécurité dysfonctionnelles… « Le P-DDRCS est une usine à gaz interministérielle » et son coordonnateur, Tommy Tambwe, est largement contesté en raison de son passé d’ancien rebelle du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD-Goma).
« Les millionnaires du chaos »
Si la prédation économique n’est pas la cause exclusive des conflits à l’Est, elle en reste le principal carburant. Cette prédation permet « de financer le système de conflits et génère une kleptocratie qui a transformé l’insécurité en rente économique » dénoncent Thierry Vircoulon et Marc-André Lagrange. Selon eux, il y a bien une « économie politique de la conflictualité ». Les ressources naturelles du Congo (diamants, or, coltan, cuivre, cobalt, bois d’oeuvre, faune et flore sauvages) entretiennent cette économie de la violence. « De 2000 à nos jours, l’Est congolais est passé graduellement d’une économie de guerre partagée entre plusieurs armées étrangères à une économie de guérilla partagée entre groupes armés et FARDC ». Une économie de guérilla qui a généré sa propre élite et son propre « business model » qui se résume ainsi : « extraction par la violence et commercialisation par la fraude ». Le rapport de l’Ifri décrit un phénomène souvent passé sous silence, celui des « Big Men », ces commerçants, militaires, politiciens, fonctionnaires ou ministres, qui forment ces réseaux de prédation au Congo. Ces « millionnaires du chaos tirent les ficelles derrière les conflits locaux dans une logique de profit, les amplifient et en perdent souvent le contrôle ».
Politique, business et groupes armés
Si le pouvoir a changé à Kinshasa, Thierry Vircoulon et Marc-André Lagrange estiment que ce n’est pas le cas des élites provinciales de l’Est. Trois personnalités sont analysées dans ce rapport : Robert Seninga, ex-commandant de l’ADF, du RCD, parrain du groupe armé Nyatura et actuellement président de l’Assemblée provinciale du Nord-Kivu ; Antipas Mbusa Nyamwisi, président du RCD-KML, ancien ministre et député de Butembo ; et Justin Bitakwira, ancien cadre de l’AFDL, ancien ministre et député honoraire d’Uvira. « Ces trois personnalités publiques ont pour caractéristiques d’avoir commencé leur carrière dans les violences guerrières des années 1990 et de s’être reconverties comme politiciens tout en conservant la mainmise sur un fief et ses ressources grâce à leurs liens avec des groupes armés » expliquent les deux chercheurs. Ce ne sont pas les seuls, à l’instar du député Jemsi Mulengwa, qui entretient des liens avec les Maï-Maï Yakutumba, ou Emmanuel Ramazani Shadary (patron du PPRD de Joseph Kabila) avec les Maï-Maï Malaïka. Et rien n’a changé sous Félix Tshisekedi. Car, pour asseoir son pouvoir « et mettre fin à la cohabitation avec le mouvement de Joseph Kabila, le président Tshisekedi a dû débaucher beaucoup d’élus nationaux et provinciaux ».
Des acteurs internationaux lassés
Enfin, l’échec de la politique de pacification à l’Est du Congo est aussi celui des acteurs internationaux. Toutes les initiatives pour tenter de ramener la paix en RDC ont échoué depuis bientôt 30 ans. « Alors que la question congolaise était au sommet de l’agenda international au début du siècle, elle suscite aujourd’hui surtout le scepticisme et le désintérêt dans les cercles internationaux ». Si les casques bleus de la Monusco bénéficiaient encore d’un consensus fort lorsqu’ils ont défait les rebelles du M23 en 2013, ils sont aujourd’hui cantonnés à un simple rôle d’observateurs impuissants et désormais contestés par les populations de l’Est. Les chercheurs datent la marginalisation des Nations unies sur le dossier congolais au « glissement » des élections de 2016. Plusieurs facteurs expliquent l’impasse dans laquelle se trouve la politique de pacification de la RDC : une économie de guérilla prédatrice, « un même répertoire usé de fausses solutions » basé sur une réponse essentiellement militaire sans régler les problèmes de gouvernance, et une impunité généralisée, censée « consacrer la paix ». Thierry Vircoulon et Marc-André Lagrange regrettent enfin « les solutions techniques » des acteurs internationaux face à un problème de mauvaise gouvernance. Aujourd’hui, les milliards de dollars déversés sur le Congo, sans résultat, ont fini par lasser la communauté internationale, victime d’une « Congo fatigue ». Les chercheurs rappelant que le retour de la paix passe avant tout « par une réforme de gouvernance en RDC et probablement aussi dans les pays des Grands Lacs ».
Christophe Rigaud – Afrikarabia
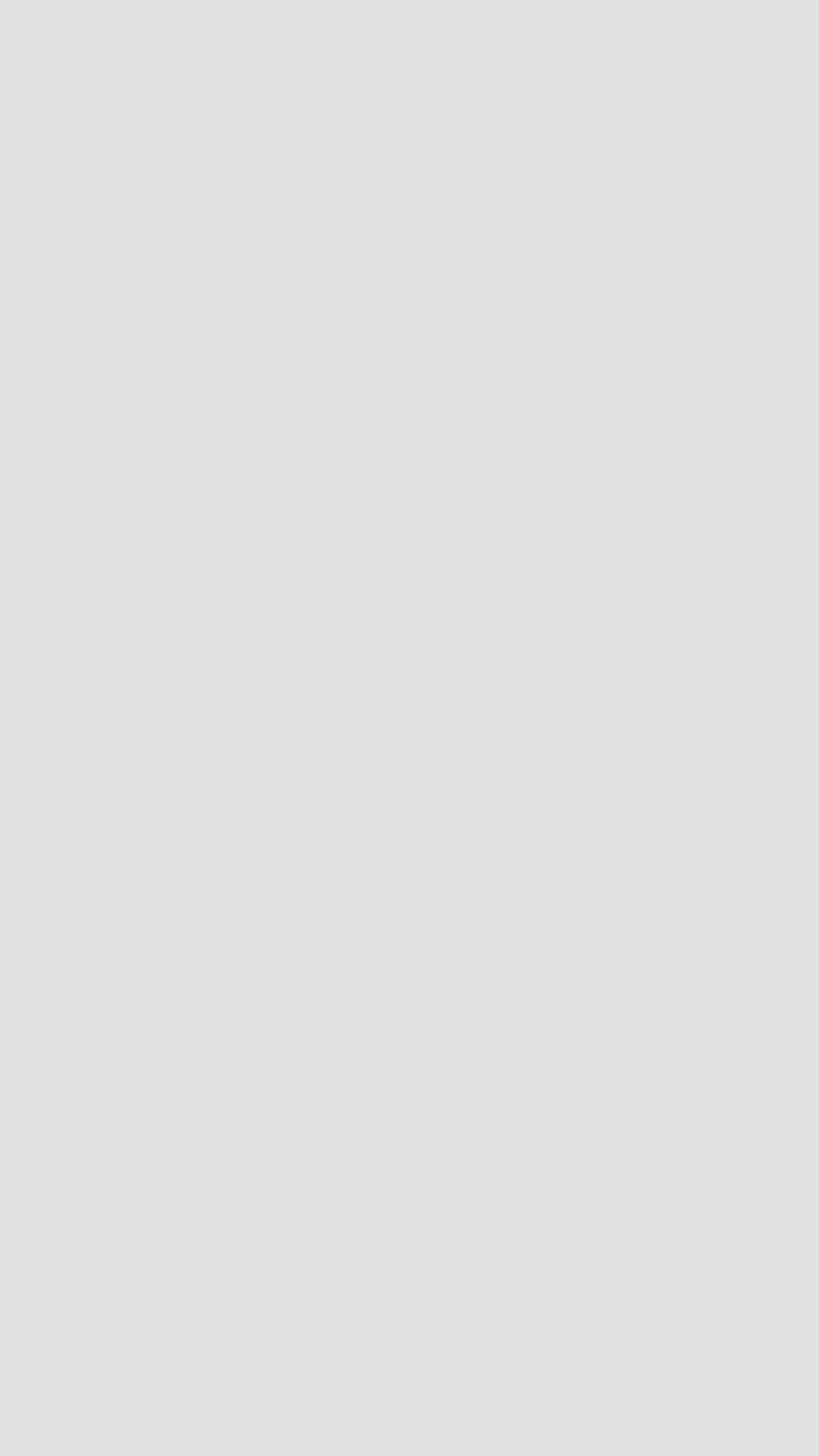

 envoi en cours...
envoi en cours...


















J’ai lu avec attention le rapport deThierry Vircoulon et Marc-André Lagrange. Leur analyse est intéressant sur certains aspects.
Toutefois, deux aspects cruciaux sont oubliés dans leur analyse alors qu’ils sont plus explicatifs du chaos qui règne dans cette partie de l’Est de la RDC:
1. Le lien entre la présence des FDLR en RDC avec leur idélogie génocidaire et la pérsecution des Tutsis Congolais et leur exil dans les pays limitrophes. C’est dans des camps de réfugiés situés dans ces pays où sont recrutés les membres du M23. Tant et aussi longtemps que ce lien n’est pas brisé, le chaos durera. C’est une question de droit inaliénable pour ces Tutsis Congolais et il en vas de leur survie.
2. Les compagnies occidentales, soutenus par leurs pays, il va s’en dire (defendre leurs intérêts comme ils disent), préfèrent le chaos permanent qu’à la paix en RDC pour pouvoir continuer d’exploiter les richesses du sol congolais gratuitement ou presque. A titre indicatif, dans certains coins de Walikare, on y entre pas sans la permission de certaines compagnies venues d’Amérique ou d’Europe. Il en est de même pour les compagnies chinoises dans certaines localités du Sud Kivu.
Pour acteurs tirent avantages du desordre qui règne en RDC, y compris la MONUSCO, des ONGs et même certains chercheurs et médias!!! Je ne veux pas citer des noms.
Mr Kayijamahe,
Je viens vous poser une ou deux questions même si la dernière fois j’avais décidé de ne plus débattre avec vous parce que j’ai compris d’où vous parliez : entre deux chaises et vous semblez ne pas clairement l’assumer :
– Vous reprochez à l’auteur de ne pas évoquer le lien de l’insécurité dans l’Est avec la présence des FDLR qui gardent une idélogie génocidaire et pérsecuteraient les Tutsis Congolais obligés de s’exiler dans les pays limitrophes d’où ils s’enrolent dans le M23 ;
1. quelle est votre connaissance de ces FDLR toujours décisifs que la présence des Tutsi à la tête du Congo pendant près de deux ans et au moins deux campagnes de l’armée rwandaise n’ont pu déloger ?
2. d’où tirez-vous cette belle fable d’un M23 qui s’expliquerait par la présence des FDLR alors qu’il tue à tout va des Congolais indiscriminés ?
3. vous parlez comme d’une évidence biblique des « Tutsi Congolais » mais vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ils posent problème ; s’ils etaient si automatiquement Congolais pourquoi on ne leur connaît pas toujours leur nationalité pas quand même parce gratuitement toute la terre ne voudrait d’eux ?
En attendant n’oubliez pas que des Banyarwanda Hutu vivaient et vivent tranquillement bien intégrés sans poser des problèmes inextricables depuis la colonisation dans ce même Nord- Kivu…
Des acteurs internationaux lassés ? Ou qui laissent faire pour tirer profit ?
Et si on arrêtait de chercher sans cesse des excuses au gouvernement congolais? Depuis des dizaines d’années, les politiciens corrompus et incompétents ont raté toutes les occasions de développer ce pays qui regorge de richesses.