Lorsque l’amiral Jacques Lanxade devint chef d’état-major des armées (CEMA) en 1991, il choisit le colonel Dominique Delort comme son Conseiller Afrique. Saint-cyrien, ce dernier avait notamment commandé un régiment à Djibouti et il était intervenu plusieurs fois au Tchad. Au poste de conseiller du CEMA, Dominique Delort devient un des principaux relais de la politique française au Rwanda. Il y alterna la conduite d’engagements militaires « indirects » et la participation aux négociations de paix entre la rébellion du Front patriotique rwandais (FPR) et le régime du président Juvénal Habyarimana. En 1993, le colonel Dominique Delort exerça le commandement opérationnel du détachement français au Rwanda pour bloquer une puissante offensive du Front patriotique et empêcher la prise de Kigali. Ce fut sa dernière mission au « Pays des Mille Collines ».
Aujourd’hui général à la retraite, Dominique Delort s’était tenu à l’écart des débats sur la coresponsabilité de François Mitterrand et de son entourage dans le génocide des Tutsi du Rwanda en 1994. Peu médiatisé, presque inconnu du grand public, Dominique Delort révèle son rôle dans « Guerre au Rwanda, l’espoir brisé, 1991-1994 », un livre de mémoires qu’il vient de publier aux Editions Perrin. Il a accepté de répondre aux questions d’AFRIKARABIA

AFRIKARABIA : – Général, qu’est-ce qui vous a amené à vouloir expliquer votre rôle au Rwanda, presque trente ans plus tard ?
Général Dominique DELORT : – Une des raisons, c’est de constater le peu d’informations en France sur les événements qui ont précédé le génocide, dont j’ai été l’acteur et le témoin direct, à la fois au Rwanda et dans les coulisses des négociations de partage du pouvoir entre le régime du président Habyarimana et la rébellion du FPR/APR. Beaucoup de livres ou d’articles sont centrés sur le génocide des Tutsi du Rwanda en 1994, très peu abordent la période qui précède. Le gros rapport de la Mission d’information parlementaire de 1998 est intéressant, mais ne fait que survoler ce que j’ai vu et vécu durant cette période, à compter de ma découverte du Rwanda en décembre 1991, jusqu’à l’achèvement de ma mission fin-1993. Il m’a semblé important de reprendre ce cadre, de restituer la chronologie. Je ne me considère pas comme un historien, mais comme un acteur-témoin.
Votre livre paraît moins d’un mois avant la publication du rapport de la Commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsi (1990-1994), dite « Commission Duclert », du nom de son président. [1] C’est intentionnel ?
Après la création de cette commission par le président de la République en 2019 j’ai rencontré deux fois Vincent Duclert (sans être auditionné) et je lui ai donné mon sentiment. Mais mon livre était en gestation depuis longtemps. J’ai remis le manuscrit initial aux Editions Perrin à la fin de mars 2020. C’est l’éditeur qui a choisi la date de diffusion, ce mois de mars.
J’ai servi l’armée française jusqu’en 2005. Ensuite on m’a commandé un premier livre. Je pensais que je devais écrire sur le Rwanda. Si l’on voulait comprendre l’action de la France, il fallait restituer le cadre. C’est le premier chapitre : le discours du président Mitterrand à La Baule. Il est fondateur d’une politique pas si simple : l’état de droit, la démocratie, les libertés individuelles, le conditionnement de l’aide de la France au développement de la démocratie.
« Mitterrand à La Baule est fondateur d’une politique pas si simple »
D’autre part j’ai voulu rappeler que si le Rwanda connaissait une crise, ce n’était pour Paris qu’une crise parmi bien d’autres, et qu’elle retenait moins l’attention ce qu’on croit aujourd’hui. Beaucoup de gens imaginent qu’on était concentré sur le Rwanda, ce n’était pas le cas. Les années 1990 ont été particulièrement conflictuelles. Il y avait d’abord le feu dans les Balkans, Djibouti, le Togo, le Tchad…
Voulez-vous dire que Paris a pu être négligent sur l’analyse de la guerre civile au Rwanda ?
Je dirai plutôt que la faiblesse tient au passage de relai à l’ONU en 1993. Il y a des explications. A commencer par le binôme du représentant spécial de l’ONU au Rwanda, un diplomate camerounais, et du général canadien commandant la MINUAR. [2] Ni l’un ni l’autre n’ont pu trouver suffisamment de recul. C’était un système bancal pour gérer une très grave crise.
Dès les premières pages de votre livre, on comprend qui vous preniez des notes, que vous les avez conservées, que vous avez également des archives personnelles ?
C’est une méthode qui m’a été inculquée par mon père qui était un « Poilu ». Il est parti à la guerre en 1914, à 18 ans, et il est décédé en 1992. Il avait immédiatement pris des notes. Lorsque je suis parti en opération extérieure, il m’a montré ses petits carnets Parker et m’a dit « n’oublie pas de prendre des notes ». Ca m’a permis d’écrire un premier livre sur mon expérience du Liban et du Tchad.
J’ai constaté que votre ouvrage était exempt des préjugés qui émaillent malheureusement les récits et les exposés d’autres officiers supérieurs de la « Coloniale ». Vous n’êtes, à vous lire, ni ethniste, ni tribaliste, ni raciste, ni conspirationniste. Vous ne semblez pas un adepte de la thèse du « double génocide » au Rwanda, vous avez conscience que le génocide des Tutsi était planifié. Et concernant les auteurs de l’attentat du 6 avril 1994 qui donne le signal du génocide, vous n’avez pas d’opinion arrêtée. Le titre de votre ouvrage, « Guerre au Rwanda, l’espoir brisé » est neutre. Vous ne convoquez pas l’émotion, le pathos, « l’honneur », « les larmes », comme certains…
Là aussi soyons clairs : sur la base des informations que j’avais à l’époque, je ne suis pas en mesure de dire ou d’écrire que le génocide était planifié au moment où se déroulaient les négociations d’Arusha. Pour la deuxième partie de votre question, mon attitude n’est pas particulière au Rwanda.
« Sur la base des informations que j’avais à l’époque, je ne suis pas en mesure de dire que le génocide était planifié »
Au service de la France, dans les opérations armées et les gestions de crises auxquelles j’ai participé, j’ai toujours veillé à observer une certaine distance. Vous avez vu en quatrième de couverture que je suis né à Alger. Sans être Pied noir, la tragédie algérienne m’a amené à réfléchir durablement. Pour servir son pays, il faut conserver l’esprit clair. On n’est pas forcé d’adopter le point de vue d’une des parties en conflit. Il faut savoir garder un équilibre. Si je ne l’avais pas compris auparavant, les retournements de situation au Tchad me l’auraient enseigné. Il ne faut pas croire que c’est du détachement. C’est assez difficile. De même, ne rien promettre qui soit excessif. Je l’ai rappelé à mes interlocuteurs dans différentes crises, pas seulement au Rwanda : ne rien promettre qu’on ne puisse tenir.
Imaginer que l’ONU pourrait prendre la suite de Paris pour assurer l’application des Accords d’Arusha, n’était-ce pas une promesse hasardeuse ? Certains, y compris parmi vos frères d’armes, ont dit « si Paris était resté au Rwanda, il n’y aurait pas eu de génocide » ?
On a effectivement entendu beaucoup de critiques, mais la politique de la France ne se fait pas sur la rive gauche.
Vous pensez à quelqu’un en particulier ?
J’aime beaucoup Pierre Conesa, son intelligence et la profondeur de ses réflexions, mais la décision politique ne se prend pas à Sciences Po ou dans des ONG. Il est normal que la Direction des Affaires Stratégiques, parmi d’autres services, nourrisse la réflexion d’un ministre, du chef d’état-major (CEMA), d’autres ministères. Mais ce n’est pas l’auteur d’une note qui prend la décision.
« La décision politique ne se prend pas à Sciences Po ou dans les ONG »
Je pense à la discussion entre Foch et Clémenceau sur la fin de la Première guerre mondiale. Foch voulait poursuivre l’armée allemande, prendre la rive gauche du Rhin pour marquer la victoire définitive. Clémenceau, lui, avait la responsabilité politique et la pression américaine. Une reddition de l’Allemagne aurait-elle mieux valu que l’armistice ? Après l’attaque de la Pologne en 1939, on entend aussi des débats sur ce qu’il aurait été mieux de faire. Ca me semble pourtant assez vain.
Vous revenez à plusieurs reprises dans votre livre sur la stratégie d’interposition qui a été adoptée par Paris au Rwanda. Ne peut-on parler d’une erreur stratégique ?
C’était le choix du président Mitterrand. Ce n’est pas à moi, militaire, d’apprécier la pertinence de ce choix. La jauge était minimale : 150 hommes ! Ce n’est rien comparé à d’autres engagements de la France, au Tchad, dans l’ex-Yougoslavie.
Barkhane aujourd’hui, c’est 5 500 hommes.
« au Rwanda, ce n’est pas avec 150 hommes que nous allons réduire la rébellion »
Lorsque je découvre le Rwanda aux côtés de l’amiral Lanxade fin 1991, nous y tenons plusieurs réunions. Le chef d’état-major rappelle à nos interlocuteurs rwandais cette stratégie de protection. Dans l’avion du retour, Lanxade poursuit à voix haute cette explication. Ce n’est pas avec 150 hommes que nous allons réduire la rébellion. D’autant qu’elle est appuyée par un pays voisin important, l’Ouganda. La stratégie indirecte est une constante.
Par la suite on met des poids dans la balance pour maintenir l’équilibre, toujours par une stratégie indirecte. J’ai identifié par la suite, parmi mes interlocuteurs rwandais, un homme exceptionnel, Boniface Ngulinzira, un Tutsi. Entre 1992 et 1993, comme ministre des Affaires étrangères, il fait preuve d’une très grande habileté dans les négociations qui aboutiront à l’accord de paix d’Arusha. Cet espoir a été malheureusement brisé. Ngulinzira sera assassiné au début du génocide. Vous avez remarqué que mon livre lui est dédié.
Votre manuscrit a-t-il été soumis au ministère de la Défense ?
Pas du tout. J’ai montré mon manuscrit à l’amiral Lanxade et au général Mercier, qui sont longuement cités dans le livre. Ils ne m’ont pas demandé le moindre changement. Rien.
Vous parlez d’un sujet « très difficile, délicat, sensible politiquement » et de votre « devoir de réserve ». Est-ce que la vérité peut émerger de tant de difficultés et contraintes ?
Je pense que oui. Je ne règle pas de comptes. Il y a des gens que je cite, d’autres que je décris un peu. Par exemple Jean-Marc de la Sablière, que je considère comme un vrai grand diplomate…
En lisant votre éloge de Jean-Marc de la Sablière, on a l’impression que c’est une façon d’égratigner Paul Dijoud, qui fut son prédécesseur – jusqu’à l’été 1992 – à la direction des Affaires africaines et malgaches au Quai d’Orsay ?
Une forte personnalité, beaucoup de volonté, mais il ne me semblait pas réceptif…
Vous parlez d’un « cadre éthique choisi, accepté et revendiqué, celui de l’armée française » Vous ajoutez que « la force d’une armée dépend de sa discipline, de sa cohésion comme de son savoir-faire » ?
N’oubliez pas la phrase précédente : la force reste au service du droit dans le cadre de l’intérêt général du pays…
N’avez-vous pas le droit de vous interroger sur la pertinence de la mission ?
Il manque peut-être quelque chose : n’avez-vous pas le droit de vous interroger sur la pertinence de la mission ?
C’est une excellente question. J’y réponds en partie lorsque j’évoque le cas de conscience qu’a pu avoir le général Dallaire, au moment où il constate qu’il n’a pas les moyens de sa mission. Lorsqu’il alerte l’ONU pour obtenir davantage de moyens et lorsqu’il réclame d’être placé en « chapitre VII », c’est-à-dire en capacité d’employer la force. Je pense qu’un chef, constatant qu’il n’a pas reçu les moyens de sa mission, doit l’exprimer, et s’il n’est pas entendu, doit démissionner.
C’est ce que dit le général Lafourcade[3] dans son livre. Mais vous-même n’apparaissez jamais dans votre récit comme un officier supérieur susceptible de poser une démission ?
Bien au contraire. J’ai beaucoup étudié les conflits précédents, notamment la guerre d’Algérie. Si foncièrement on n’accepte pas quelque chose, il faut le dire et en tirer les conséquences. C’est un sujet qui m’a toujours accompagné.
« Poser une démission ? C’est un sujet qui m’a toujours accompagné »
Vous écrivez « Les principales autorités françaises pressentaient, au moins depuis 1992, une probable catastrophe humaine en cas d’échec, évidemment pas un génocide. Ce fut dit, ce fut écrit. »
Pourquoi ces messages ne furent-ils pas entendus ? Vous-même relayez dans un de vos rapports un avertissement du chef d’état-major rwandais, le colonel Déogratias Nsabimana, sur le risque de très grands massacres, et vous découvrez que ce passage de votre rapport a disparu dans les arcanes du ministère de la Défense. Pourquoi ?
Dès la sortie de mon rapport, il est ventilé vers le ministre de la Défense, vers le ministère de la Coopération et vers le ministère des Affaires étrangères. Ce qui n’est pas repris de mon rapport de mission par la note du ministre, c’est l’avertissement exprimé par Nsabimana, auquel je crois.
Cet avertissement est donné aussi dès la fin 1990 par plusieurs personnalités, et pourtant il n’est pas entendu. Pourquoi ?
Je ne suis pas sûr que ce message ne soit pas entendu. Je pense plutôt que qu’il est traduit par une feuille de route à tous les niveaux : sortir le Rwanda de la crise. On ne peut pas dire « on vous laisse vous massacrer, on s’en va ». D’où la volonté constante d’amener les deux parties à la négociation. Paris accompagne la négociation de paix jusqu’à son terme, mais l’ONU est incapable de forcer les parties à appliquer l’accord.
Pour appliquer un accord, il faut que les deux protagonistes en aient la volonté et les moyens. Or à plusieurs reprises vous décrivez le président Habyarimana comme un homme dépassé, qui ne fait plus confiance à ses militaires. Vous le qualifiez de « désorienté ». Il contribue aussi à obscurcir l’analyse de François Mitterrand, et parlant d’agression étrangère. Vous-même analysez une guerre civile. Vous écrivez que le 1er octobre 1990 « c’est le début de la guerre civile ». Pourtant, en 1994, les archives de l’Elysée montrent un François Mitterrand se demandant s’il s’agit d’une guerre civile ou d’une guerre d’agression. Une posture dénuée de sens ?
Je décris Habyarimana tel qu’il m’est apparu. M’accueillant en 1992 dans ce petit salon mal éclairé de sa villa, alors que son armée ne répond plus et qu’il ne comprend pas ce qui se passe. Abattu. Effondré.
« Je décris Habyarimana tel qu’il m’est apparu. Abattu. Effondré. »
Cela ne veut pas dire qu’il était tous les jours comme ça. Beaucoup de grands décideurs en passent par-là : des jours de pleine forme et d’autres où ça ne va pas du tout. Chaque fois que je rencontre le président du Rwanda, il est différent.
Ce personnage sur lequel s’appuie Paris, ce « leader du peuple hutu » n’est-il pas tout simplement pour l’Elysée une mauvaise pioche ?
C’est le choix de la France. Il semble le seul interlocuteur étatique possible. Il a une légitimité.
Général, j’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre narration de votre découverte du Rwanda. L’amiral Lanxade décide d’aller passer Noël 1991 avec les militaires français au Rwanda, vous partez avec lui, et vous participez à des réunions de travail au plus haut niveau sur place.
Exactement au même moment, le président Habyarimana a confié au colonel Bagosora de réunir une commission de dix des plus hauts gradés du Rwanda pour « définir l’ennemi ». Cette commission produit un texte que je considère comme le socle du génocide : l’ennemi est défini comme le Tutsi. [4]
Vous ne parlez pas dans votre livre de ce document : « Définition de l’ennemi » ?
J’ai été étonné que vous n’en parliez pas dans votre livre et je vous ai adressé avant l’interview ce document « Définition de l’ennemi », ou plus exactement la vingtaine de pages qu’on en connaît. Pourquoi n’en parlez vous pas ?
La raison en est simple : je n’avais jamais entendu parler de ce document auparavant.
J’en suis surpris, vu le contenu de ce texte. Mais j’avais déjà observé que le Mission d’information parlementaire de 1998 ne le retenait pas. Pourtant, le colonel Michel Robardey, qui était alors l’adjoint de l’Attaché de Défense à Kigali, affirme que tous à l’ambassade connaissaient ce texte. Doit-on en conclure que les militaires français présents au Rwanda ont choisi de ne pas le faire « remonter » ?
Ce document, je ne l’avais jamais vu avant que vous me le communiquiez.
L’ambassadeur de France Georges Martres est décédé. Son successeur Jean-Michel Marlaud m’a dit qu’il n’avait jamais entendu parler de ce document. Au contraire du colonel Michel Robardey.
Au procès du capitaine Pascal Simbikangwa devant la Cour d’assises de Paris, Michel Robardey, cité par la Défense, a été interrogé par Me Simon Foreman avocat d’une partie civile. Je vais vous lire un extrait du compte rendu d’audience.
Me Simon Foreman : – Que pensez-vous du document « définition de l’ennemi », rédigé par la « commission Bagosora » en décembre 1991, et diffusé dans les garnisons du Rwanda à partir de septembre 1992 ?
Colonel (ER) Michel Robardey : – Je l’ai regardé à la loupe. C’est un texte éminemment critiquable, comme tous les textes… mais qui a été présenté de façon déformée… néanmoins c’était un texte dangereux, j’en conviens. C’est terrible, dans l’esprit des rédacteurs de ce texte, l’effet escompté était justement de faire en sorte que tous les Tutsi ne soient pas incriminés ».
« Le colonel Cussac ne m’en a jamais touché un mot »
Le colonel Robardey paraît bien renseigné sur la genèse de ce texte, sur les intentions de ses auteurs. Comprenez-vous qu’on ne puisse écarter le soupçon que des officiers français, qui à un moment seront sous vos ordres, ont pu collaborer à la rédaction de ce texte si dangereux ? A peu près au moment où vous-même et l’amiral Lanxade étiez à Kigali ?
Je ne peux que vous répéter que je n’ai jamais entendu parler de ce texte et que le colonel Cussac, que j’ai rencontré souvent, ne m’en a jamais touché un mot. Vous voyez que, moi qui suis allé un certain nombre de fois au Rwanda, j’ai encore des choses à apprendre.
« Vous n’en avez jamais parlé au colonel Jean-Jacques Maurin, son adjoint ? »
Malheureusement Cussac vient de décéder. Vous n’avez pas interrogé le colonel Jean-Jacques Maurin son adjoint, qui était chargé de faire la liaison avec l’état-major des FAR ?
Effectivement, vous rappelez dans votre livre avoir fait nommer le colonel Maurin comme conseiller de l’état-major des FAR le 9 mars 1992. Il était au coeur de la fraternité d’armes. On sait aujourd’hui que certains de ses interlocuteurs préparaient l’extermination des Tutsi.
Je vous réponds très franchement ; lorsque j’étais à Kigali, j’ai souvent dîné avec Maurin. Evidemment, nous parlions de la situation. Il ne m’a jamais mentionné un projet génocidaire.
Il n’a jamais accepté de parler avec des journalistes, ce qui nourrit le soupçon. Dans son livre, le général Tauzin le décrit comme un va-t-en guerre, pas du tout comme un adepte de la interposition. [5] Si un officier français pouvait avoir connaissance du projet génocidaire, c’était lui.
Il ne serait pas inutile qu’il vous réponde sur ce point mais, selon moi, il n’en avait pas connaissance.
Nous sommes au cœur d’un questionnement important, celui de la dissimulation de la préparation du génocide. Je résume : durant le dernier trimestre de 1990, l’ambassadeur Georges Martres indique dans ses télégrammes diplomatiques le risque d’extermination des 700 000 tutsi du Rwanda – c’est son estimation chiffrée. L’attaché de Défense, le colonel René Galinié, évoque ce même risque.
Général, aucune alerte du risque de génocide durant trois ans ?
Le général Varret entend le responsable des Far, le colonel Serubuga, lui confier que l’extermination des Tutsi est envisageable. Le colonel Rwagfilita, patron de la gendarmerie, lui dit aussi « les Tutsi sont très peu nombreux, nous allons les liquider ». Le général Varret en parle au président Habyarimana, qui esquive.
Tout ça en trois mois. Et durant les trois années qui suivent, rien. Général, aucune alerte de risque de génocide venant aux oreilles des militaires ou diplomates français. Rien de porté à votre connaissance. Comme si le projet génocidaire était une sorte de sous-marin désormais en immersion. N’est-ce pas difficile à croire ?
J’ai tenu à ne raconter dans mon livre que ce que j’ai lu, vu, vécu, entendu. Et je n’ai rien entendu de tel.
Vous exposez très clairement les chaînes et processus de décision à l’Elysée, dans les ministères, chez les diplomates, au niveau de l’armée, y compris rivalités de compétence qui semblent avoir coûté son poste au général Varret. Votre exposé est clair et convaincant sur la qualité des processus décisionnaires. On comprend d’autant moins qu’un document aussi important que « Définition de l’ennemi » ait pu vous échapper…
(soupir) La partie évidemment qui heurte, ce sont les premières lignes, la définition de l’ennemi comme étant le Tutsi…
Dans une guerre, et plus encore dans une guerre civile, il est légitime pour l’autorité politique de définir l’ennemi. Mais Paris ne peut justifier d’appuyer une armée pour qui l’ennemi, c’est « l’adversaire racial », le Tutsi ? L’ambassadeur de France Jean-Michel Marlaud m’a raconté qu’à sa prise de fonction, il avait été stupéfait que l’attaché de Défense, dans ses télégrammes à Paris, n’écrivait pas « le FPR » ou « l’APR » mais « l’ennemi », et il avait aussitôt mis un terme à cette pratique.
Je reviens sur ces problèmes parce que dans votre livre les aspects idéologiques de la guerre civile me semblent peu abordés…
Je laisse à M Marlaud la responsabilité de ce qu’il vous a dit concernant le colonel Cussac, je ne suis pas d’accord. Personnellement, je ne voyais pas cette approche dite « raciale » de la crise rwandaise.
« Je laisse à M. Marlaud la responsabilité de ce qu’il vous a dit concernant le colonel Cussac »
Lors des négociations d’Arusha, le chef de la délégation du FPR était Pasteur Bizimungu, un Hutu. Le président du FPR, Alexis Kanyarengwe, était Hutu. J’avais une grande estime pour le chef de la délégation rwandaise, le ministre des Affaires étrangères Boniface Ngulinziza. J’ignorais et je ne cherchais pas à savoir s’il était hutu ou tutsi. J’ai retenu une de ses phrases : « Ce n’est pas l’ethnie qui fait l’âme et la valeur d’un homme ». La population était composée de Hutu et de Tutsi qui semblaient plutôt bien cohabiter.
Il y avait pourtant un racisme d’Etat au Rwanda, des quotas ethniques. Peut-être n’avez-vous pas été assez sensible à la racialisation de la guerre civile ?
En découvrant ce document « Définition de l’ennemi », je ne peux pas vous donner tort. Mais qui imaginait un génocide ? Le colonel Nsabimana, chef d’état-major des FAR, exprimait la crainte de « grands massacres ». Pas d’un génocide. Qui pouvait être mieux informé que lui ? Lui-même semblait croire que la paix allait l’emporter.
« Le chef d’état-major des FAR ne pensait pas à un génocide »
Nelson Mandela et Frederik de Klerk ont jugulé les racistes de leur propre camp. Il s ont eu le prix Nobel de la paix. Je ne pense pas qu’il en ait été question pour Juvénal Habyarimana et Paul Kagame ! Aucun des deux n’a fait un réel effort de conciliation vers l’autre. La situation n’était pas idyllique, mais il y avait cet espoir qui a été brisé au soir du 6 avril 1994.
Je reviens sur l’expression « Khmer noir » dont vous précisez dans votre livre que vous auriez été le premier à la médiatiser pour désigner la rébellion du FPR en 1993. Vous racontez dans votre livre que l’expression vous aurait été « soufflée » par un médecin français ?
J’ai rencontré ce médecin dans un camp de déplacés aux abords de Kigali. Il arrivait du Cambodge. Il était très marqué parce qu’il avait vu là-bas et très touché aussi par la situation misérable des déplacés au Rwanda. Il trouvait qu’il y avait une forte similitude avec ce qu’il avait vu au Cambodge, et il employa cette expression qui m’est restée en tête : « Le FPR se comporte comme des Khmers noirs ». J’eus l’imprudence de citer ce médecin, avec ses propos, lors d’un échange quelques semaines plus tard, le 24 mars avec une journaliste. Je le précise dans mon livre. France Inter diffusa cette histoire plus tard, le 28 mars, à 13 h 15.
Cette formule « Khmers noirs » qui inverse la responsabilité de la furie génocidaire, a constitué un marqueur du discours négationniste par la suite. Mais il me semble que d’autres l’avaient utilisée avant vous ?
Je n’ai employé ce terme qu’une fois. Je ne crois pas en être l’inventeur et pour cause. J’ai écrit qu’il était malencontreux.
« Je ne crois pas être l’inventeur du terme « Khmers noirs » »
Permettez moi d’aborder un sujet qui m’intéresse particulièrement car je lui ai consacré un livre[6] : c’est la question des « interceptions radio du Front patriotique » par le « G2 » rwandais, dirigé par le colonel Anatole Nsengiyumva. Vous mentionnez page 67 la mort d’une religieuse et vous écrivez « selon des interceptions radio, le FPR paraît ravi de ces actions et de la mort d’une Française ». Cette « interception » paraît invraisemblable. L’ex-religieuse – une Italienne, Antonia Locatelli – a été assassinée par un gendarme rwandais pour avoir dénoncé sur les ondes de RFI une tuerie de Tutsi. Cet épisode est parfaitement documenté. N’aviez-vous pas conscience que le service de renseignement militaire rwandais consacrait beaucoup d’énergie à intoxiquer les Français ?
Je mentionne à plusieurs reprises le nom du colonel Nsengiyumva pour préciser que cet individu m’était apparu intelligent mais antipathique, pour tout dire, pas fiable. J’ai aussi écrit qu’il a été condamné par le Tribunal pénal international pour le Rwanda.
« Je n’avais guère confiance dans les interceptions de l’armée rwandaise »
Globalement, je n’avais guère confiance dans les interceptions de l’armée rwandaise. Pour conserver ma qualité d’information et mon indépendance de jugement en 1993 j’ai fait venir des véhicules d’écoute et deux véhicules « gonio » avec leurs spécialistes pour localiser les postes émetteurs du FPR.
Le génocide a été programmé, préparé, par une structure politico-militaire parallèle où le colonel Nsengiyumva semble avoir joué un rôle important. Comment se fait-il que dans le cadre de vos réunions avec l’état-major des FAR, ou avec des gradés rwandais sur le terrain, le soupçon de conspiration n’apparaisse pas ?
C’est exact, ce soupçon n’apparaît pas. Je peux vous apporter plusieurs explications. D’abord, mes contacts à l’état-major ne concernent que le chef d’état-major, et je vous ai dit que le colonel Nsabimana lui-même n’imagine pas un génocide. Nsabimana était un modéré. Pas le genre à rêver de tuer des Tutsi. Le colonel puis général Kabiligi, que je connaissais également, sera acquitté de participation au génocide par le TPIR. J’ai bien vu sur le terrain que Kabiligi n’était pas non plus ethniste.
« Nsabimana était un modéré. Pas du genre à rêver de tuer des Tutsi »
Vous ne pouvez écarter l’hypothèse que si ces deux hommes, parmi les plus hauts gradés de l’armée rwandaise, n’étaient pas informés de la conspiration génocidaire, j’étais encore moins bien placé pour en connaître.
Ensuite l’impression que j’ai eu d’emblée concernant le responsable du Renseignement, Anatole Nsengiyumva. Il était très antipathique. Un dur-à-cuire. A l’évidence un CDR [7], un extrémiste. Autant vous dire qu’il ne m’a pas fait de confidences…
La politique de l’Elysée consistant à maintenir l’équilibre entre les deux parties armées, les FAR et le FPR…
Non : la politique d’amener les deux parties à négocier autour d’un tapis vert…
Je vous cite Général, page 68 : « « Dès que les négociations s’ouvriront, il sera important que la situation reste équilibrée sur le terrain ».
Oui, parce que c’est une des conditions de la négociation. J’ai écrit ce livre pour une plus grande part de vérité. Je suis intervenu, sous les ordres de l’amiral Lanxade, dans le domaine militaire pour amener les deux parties à la négociation. L’objectif était un règlement négocié, j’insiste là-dessus. L’Elysée avait écarté l’hypothèse de la destruction de la rébellion. L’amiral s’est montré clair dans son exposé, au cours du vol qui nous ramenait de Kigali en décembre 1991 : aucune chance de détruire la rébellion, qui bénéficiait d’une zone de repli en Ouganda.
… Général, la durée de cet « équilibre », ce qu’on pourra qualifier d’enlisement, va donner aux génocidaire le délai nécessaire pour peaufiner leur programme d’extermination des Tutsi.
« Enlisement », je récuse ce terme. Au Liban, des forces françaises sont présentes depuis 43 ans et on ne parle pas d’enlisement. En géopolitique, ce n’est pas si simple. Si on avait débouché sur l’application des accords d’Arusha, tout le monde aurait dit que la crise avait été rapidement réglée.
« Les accusateurs de la politique française au Rwanda oublient généralement de mettre en cause les Américains »
J’ajoute que les accusateurs de la politique française au Rwanda oublient généralement de mettre en cause les Américains. Washington était aussi bien informé que nous, sinon mieux informé, sur ce qui se passait au Rwanda. En 1994, Susan Rice était conseillère pour les Affaires africains au Département d’Etat américain (elle a encore obtenu de hautes responsabilité dans l’administration Biden). En 1994, elle est une des premières à parler d’actes de génocide au Rwanda.
Sur la position de Washington, les épisodes dont vous avez été le témoin direct me semblent très clairement décrits dans votre livre.
Ce serait bien qu’il y ait aux Etats-Unis des chercheurs aussi opiniâtres qu’en France pour se pencher sur les archives de la NSA… Quel dommage que les Américains ne nous aient pas apporté leur concours en poussant à une solution pacifique, et en aidant les deux parties à surmonter les points de blocage. Notamment le financement de la démobilisation d’une majeure partie de l’armée gouvernementale.
« J’ai relevé les propos de Mme Bushnell dans le documentaire de M. Jean-Christophe Klotz »
J’ai relevé les propos de Mme Prudence Bushnell dans le documentaire de M. Jean-Christophe Klotz, « Retour à Kigali ». [8]
C’est dommage que les Français tentent de faire quelque chose et n’en récoltent que des larmes. Pourquoi les Américains n’ont-ils rien fait ? Et Museveni ? En 1994, je m’attendais à ce que l’armée ougandaise règle la question en quelques jours. Puisse chacun battre sa coulpe… Et faire preuve de compassion pour les victimes.
« Je suis sidéré par l’ampleur du génocide »
Cette compassion, que nous devons avoir, je l’exprime à plusieurs reprises dans mon livre. Devant les victimes d’un génocide, comme tous les hommes de bonne foi, je ne peux que m’incliner. Sidéré par l’ampleur d’un massacre collectif, par cette haine collective immense qui engendre des souffrances indicibles. Le génocide des Tutsi et des Hutu par des extrémistes hutu est une ignominie qui pèsera sur ce peuple rwandais encore pendant bien des générations. Pour nous une très grande tristesse et le regret d’un espoir brisé.
Vous écrivez au début de votre ouvrage : « Il est injuste, pour ne pas dire scandaleux, et au minimum superficiel de vouloir faire porter à la France une responsabilité dans le désastre final ». Mais en quoi « La France » devait-elle s’impliquer dans l’équipée rwandaise ? Qui a consulté les Français sur l’implication française au Rwanda ?
J’ai la faiblesse d’être un républicain. Je sers les armes de la France, en officier républicain. Peu importe que j’ai voté ou pas pour François Mitterrand comme citoyen. François Mitterrand incarne la légalité républicaine, la légitimité par le élection au suffrage universel. On peut penser ce qu’on veut sur l’étendue des pouvoirs du président. La Constitution donne ces pouvoirs et cette responsabilité au Président.
Les citoyens, eux, peuvent légitimement s’interroger sur les choix du président de la République au Rwanda. Vous citez l’amiral Lanxade page 53 : « Le Président a presque un faible pour Habyarimana » Vingt pages plus loin, vous écrivez : « L’Amiral, sur le dossier rwandais comme sur les autres, veut toujours être en parfaite harmonie avec la pensée du Président. Il sait qu’il est la charnière politico-militaire du dispositif français. A lui d’ajuster l’emploi des moyens des armées aux effets politiques souhaités par le Président ».
« L’intérêt stratégique de la France au Rwanda, on peut la juger faible, évidemment »
Vous exposez très précisément votre rôle au Rwanda. Quant à la politique menée au Rwanda par un monarque républicain entouré de courtisans, on peut la juger folle… Où sont les contre-pouvoirs ? Où est l’intérêt stratégique de la France ?
L’intérêt stratégique de la France au Rwanda, on peut le juger faible, évidemment. Mais la charnière politico-militaire, c’est la charnière légale. Le Président de la République est chef des armées. C’est toujours le cas. L’exécutif est très puissant. Les Français ont choisi ce mode de gouvernance. Depuis l’affaire du Rwanda, il y a eu des correctifs. Dorénavant le chef de l’Etat ne peut plus engager durablement les armées sans passer par le Parlement.
Pourquoi alors tant de réticences dans la classe politique française à pointer la responsabilité de François Mitterrand dans le génocide des Tutsi ?
Soyons clairs sur cette question : les responsables du génocide au Rwanda, ce sont des Rwandais. Pas des Français.
Si Paris n’était pas intervenu au Rwanda, il n’y aurait sans doute pas eu de génocide. Aussi, François Mitterrand porte une certaine responsabilité dans la catastrophe ?
Je vous renvoie à mon chapitre sur La Baule. La politique du président est cohérente. Il a fixé sa ligne de conduite devant tous les présidents francophones : le soutien en échange de la démocratisation. A cette époque, on le voyait à l’état-major des armées : ca bouillonnait un peu partout en Afrique.
L’ancien officier Michel Goya, qui était sous vos ordres au Rwanda en 1992, est devenu historien de l’armée. Il a pris lui aussi du recul et après avoir lu votre livre il écrit : « Quand plus de vingt-cinq ans après les faits, des généraux français sont encore obligés de s’expliquer sur ce qu’ils ont fait et les décisions qu’ils ont prises, c’est que quelque chose n’a pas fonctionné au-dessus d’eux, ne serait-ce que le courage d’assumer clairement tout ce qui a été fait. »
Avec votre livre, vous avez, à l’évidence, ce courage. Mais tous ceux qui, dans l’entourage du chef de l’Etat, ont géré cette politique au Rwanda ? Auront-ils le courage d’exprimer ne serait-ce qu’un regret, comme l’américaine Prudence Bushnell ? qu’ont dit ou écrit l’amiral Lanxade, le général Christian Quesnot, le général Jean-Pierre Huchon, le diplomate Brunon Delaye, l’ancien secrétaire général de l’Elysée Hubert Védrine ? Depuis un quart de siècle, pas une expression de regret, pas même un mot de compassion pour les victimes d’une extermination, qui plus est, commise souvent avec un sadisme incroyable ?
Posez-leur la question. A chacun de répondre selon sa conscience, ce que j’ai fait.
Propos recueillis par
Jean-François DUPAQUIER
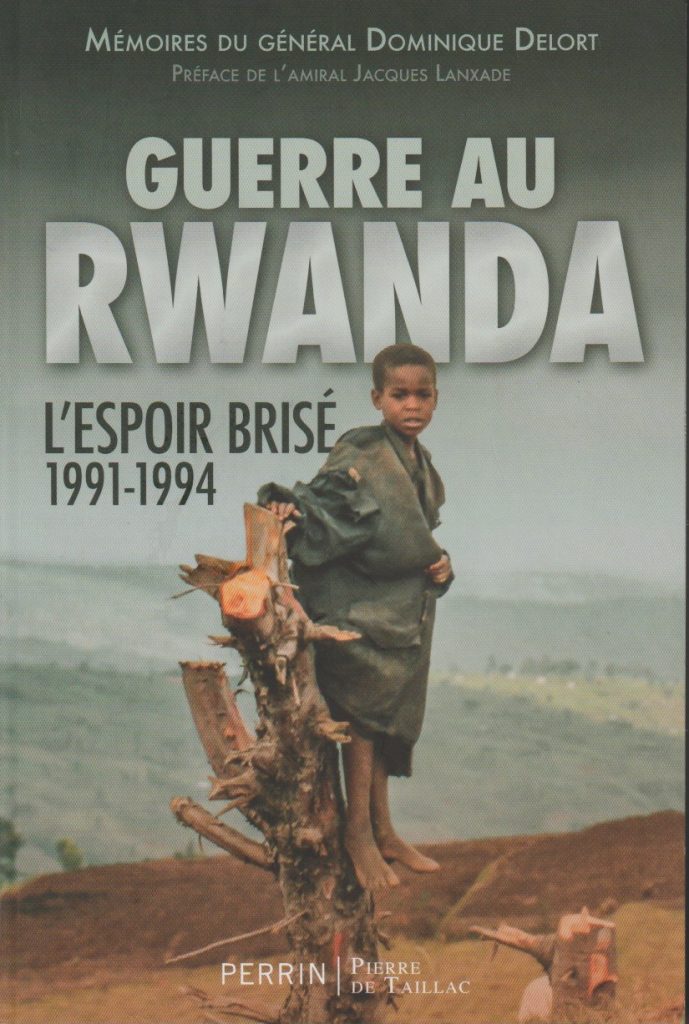
Mémoires du Dominique Delort, « Guerre au Rwanda, l’espoir brisé, 1991-1994 », Ed. Perrin/ Pierre de Taillac, Paris, mars 2021.
_________________________________________________________________________
[1] https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/rwanda/evenements/article/commission-de-recherche-sur-les-archives-francaises-relatives-au-rwanda-et-au
[2] La Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR) était une mission de l’ONU créée en octobre 1993 pour remplacer les forces françaises et faire appliquer les « accords d’Arusha » de partage du pouvoir entre l’ex-parti unique MRND, les différents partis politiques et le Front patriotique rwandais.
[3] Général Jean-Claude Lafourcade, « Opération Turquoise, Rwanda 1994 », Ed. Perrin.
[4] Lire
http://afrikarabia.com/wordpress/rwanda-paris-les-tutsi-et-la-definition-de-lennemi/
[5] Général Didier Tauzin, « Rwanda, je demande Justice pour la France et ses soldats : le chef de l’opération Chimère témoigne », Paris, Ed. Jacob-Duvernet, 2011.
[6] Jean-François Dupaquier, « L’Agenda du génocide. Les confidences de Richard Mugenzi, ex-espion rwandais », Ed. Karthala, Paris, 2010.
[7] Créée en 1992 comme dissidence dure de l’ex-parti unique MRND, la Coalition pour la défense de la République et de la démocratie (CDR) regroupait les militants hutu les plus racistes dans une mouvance dite “tendance Hutu power”. La CDR refusait de reconnaître les Tutsi comme Rwandais, au motif qu’ils appartenaient à une « race » distincte. La CDR refusa obstinément les accords d’Arusha, puis exigea de faire partie du gouvernement qui suivrait ces accords, bloquant alors sa mise en oeuvre.
[8] Prudence Bushnell exprime une opinion très critique de la politique américaine au Rwanda dans le documentaire de Jean-Christophe Klotz, « Retour à Kigali ». En 1994, elle était assistante du secrétaire d’Etat américain. Le 29 avril 1994, elle téléphona au colonel Bagosora, elle lui dit que Washington était parfaitement informé du niveau de violence au Rwanda et lui conseilla de faire en sorte que ces violences cessent. Elle parla d’actes de génocide.
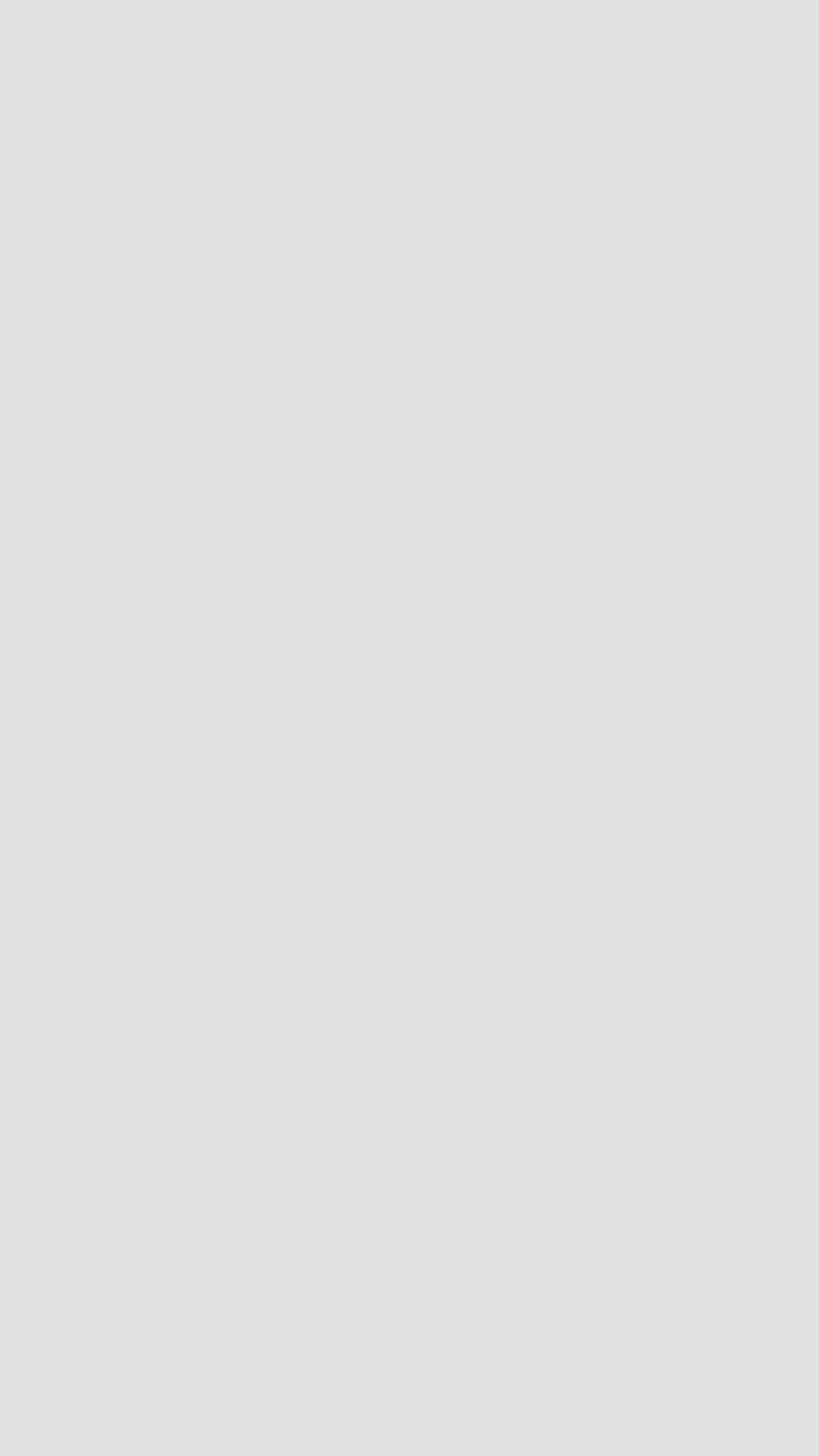

 envoi en cours...
envoi en cours...

















