Pour avoir alerté sa hiérarchie sur le risque d’extermination des Tutsi du Rwanda, le général Jean Varret avait été limogé du ministère de la Coopération en 1993, un an avant le génocide. Il revient sur cet épisode dans un livre de souvenirs et une interview exclusive pour Afrikarabia.
Afrikarabia : – Jean Varret, vous venez de publier vos mémoires sous le titre « Général, j’en ai pris pour mon grade », aux éditions Sydney Laurent. Vous aviez refusé de vous exprimer publiquement depuis votre déposition devant la Mission d’information parlementaire sur le rôle de la France au Rwanda, en 1998. Qu’est-ce qui vous a incité à rompre ce silence de vingt ans ?
Général Jean VARRET : – Comme vous l’avez lu dans ce livre, j’ai eu un accident assez grave en montagne. J’ai échappé à la tétraplégie, peut être à la mort, et j’ai été hospitalisé un an et demi, notamment aux Invalides. Contrairement à mes habitudes, ça m’a incité à « regarder dans le rétroviseur ». Durant ma carrière militaire, j’ai connu des épisodes difficiles, notamment à propos du Rwanda. J’ai pensé qu’il était temps d’écrire pour mes enfants, mes petits enfants et des amis.
J’ai donc mis à profit ces longues journées d’hospitalisation pour raconter quelques souvenirs. Ce n’est pas une autobiographie, mais des anecdotes qui ont marqué ma carrière et qui peuvent faire sens..
– Dans ce livre, vous consacrez un court chapitre au Rwanda – huit pages très denses au milieu de quelque deux cents pages. Vous revenez d’abord sur vos études, notamment à Saint-Cyr, à Saumur, puis sur votre expérience d’officier parachutiste en Algérie. Comme élève puis comme haut gradé, vous livrez des souvenirs acides sur le fonctionnement de l’armée française ?
– C’est le fil directeur de ce livre, les anecdotes se relient, je laisse au lecteur le soin d’en tirer ou pas des enseignements. Je veux surtout dire que j’ai vécu dans une armée assez particulière, bien différente de celle qu’ont connu mon grand-père, mon père ou mon gendre. Mes chefs n’avaient eu que des échecs, 1939-1940, l’Indochine, l’Algérie… Vis-à-vis d’un jeune prétentieux comme moi, ils étaient dans l’ensemble très tolérants. J’ai dit « non » plusieurs fois. En quelque sorte j’ai profité d’une faiblesse de la hiérarchie militaire face au « jeune chien » que j’étais, pour faire un peu ce que je voulais. Jusqu’à la fin. Et quand j’ai estimé que j’avais été, sanctionné à tort dans l’affaire du Rwanda, j’ai démissionné. Vous avez noté que j’ai tenté de démissionner plusieurs fois. Mais auparavant, mes demandes de démissions avaient été refusées.
Je pense que si un jeune officier se comportait aujourd’hui comme moi, il ne terminerait pas général quatre étoiles…
– Néanmoins vous livrez des anecdotes assez sombres sur l’apprentissage militaire. Même s’il y a une sorte de « dressage » inéluctable, on se retrouve parfois dans l’ambiance du roman de Yves Gibeau, « Allons z’enfants » paru en 1952, qui délivre un récit très critique de la vie des enfants de troupe. Un livre que d’ailleurs vous citez…
– C’est la vie que j’ai connue au prytanée militaire et à Saint-Cyr. Ce n’était pas le cas à Saumur Mais je dois dire que je n’ai pas une haute estime de la formation délivrée au Prytanée ni pendant les deux ans à Coëtquidan.
– Ca a changé aujourd’hui ?
– Totalement. Je suis repassé au Prytanée, c’est radicalement différent. Et Saint-Cyr est une université remarquable.
– A vous lire, on retient que les hauts gradés que vous subissez avant de devenir vous même un général quatre étoiles sont parfois d’une mesquinerie absurde, imbus d’eux-mêmes, obsédés du pouvoir d’humilier leurs subordonnés. Bref, aux antipodes des qualités de management requises dans le monde des affaires et de l’industrie où vous allez vous investir pendant les vingt années qui suivent votre démission ?
– Vous n’avez retenu que les aspects négatifs que je croyais avoir survolés. Je suis effectivement très sévère envers le général qui commandait l’école de Saumur. J’ai du mal à pardonner l’humiliation qu’il m’a fait subir. Mais j’ai eu aussi des chefs remarquables. Ce livre ne souligne pas les quelques déceptions d’une carrière largement positive
– Cependant, à de nombreuses reprises, vous « en prenez pour votre grade » – d’où le titre de votre livre -, au point d’envisager plusieurs fois de démissionner de l’armée, avant de mettre ce projet en exécution en 1993. La façon dont vous êtes évincé de vos responsabilités militaires dans l’engagement de Paris au Rwanda un an avant le génocide des Tutsi a-t-elle été la goutte d’eau qui fit déborder le vase ?
– Je n’ai pas compris pourquoi j’avais été évincé car on ne m’a donné aucune explication. Au contraire, comme je le raconte, l’amiral Lanxade m’avait demandé de rester à mon poste une quatrième année, et comme ce travail me passionnait, j’avais dit oui. Et puis quelques semaines plus tard, on me fait savoir brutalement que je suis remis à la disposition du ministère de la Défense, sans me dire pourquoi.. Durant toute ma carrière, j’ai veillé à expliquer à mes subordonnés les raisons de mes décisions Ce qui ne fut pas toujours le cas en ce qui me concerne.
– Dans ce livre, vous reprenez et précisez vos déclarations devant les parlementaires français le 6 mai 1998 sur le rôle de Paris au Rwanda. Vos propos contredisaient tous les hauts gradés entendus par la mission d’information. A cette époque, avez-vous été l’objet de pressions ou de menaces pour vous imposer le silence ?
– Non, pas du tout. Ni menaces ni intimidations. On m’a seulement fait comprendre qu’il ne fallait pas « cracher dans la soupe ». Ce n’était d’ailleurs pas mon intention. En quarante ans j’ai eu une vie passionnante et connu des chefs remarquables. Et on m’avait laissé m’exprimer
– Je pose cette question car le colonel de la DGSE Thierry Jouan, qui a raconté son expérience du génocide des Tutsi dans un roman à clef « Une Vie dans l’ombre », a été menacé de mort et en quelque sorte excommunié par ses anciens collègues du service « Action »…
– …Ceci me parait pour le moins surprenant
– Je le tiens de Thierry Jouan.
– Peut-être y a-t-il un peu d’exagération de sa part…
– Revenons à votre vécu de l’intervention militaire française au Rwanda. A l’initiative de François Mitterrand, vous êtes nommé chef de la Mission Militaire de Coopération au ministère de la Coopération en octobre 1990, au moment même du déclenchement de l’attaque rebelle du Front patriotique rwandais (FPR). Je rappelle pour nos lecteurs que c’est un poste très important : vous êtes conseiller militaire du Ministre de la Coopération et donc, membre du Cabinet du ministre. Vous avez juridiction sur plus de vingt pays d’Afrique où la France entretient une coopération militaire. Vous recevez les notes de la DGSE et, après sa création en 1992, de la Direction du Renseignement militaire. Il ne vous faut que quelques jours pour comprendre que, consécutivement à l’attaque du FPR, les Tutsi du Rwanda sont menacés d’extermination. Pourquoi ce risque vous paraît-il si vite évident ?
– Le Rwanda, dès que j’ai pris mes fonctions, a été le pays qui me posait les plus grands problèmes. J’avais sur place des interlocuteurs très compétents, notamment un lieutenant-colonel de la gendarmerie dont je parle un peu…
Le lieutenant-colonel René Galinié, Attaché de Défense au Rwanda ?
– En effet. Il appliquait les méthodes de la gendarmerie. Pour être bien informé il avait des interlocuteurs partout, notamment des membres de communautés religieuses. Très vite il m’a dit en substance « attention, il y a un danger, au Burundi comme au Rwanda, de violences politico-ethniques, de massacres. Et cette fois, le risque est très élevé.»
Tous les deux, nous avons rapidement employé les mots « risque de génocide ». Je me suis rendu plusieurs fois au Rwanda, j’y ai rencontré les chefs militaires hutu, qui ne m’ont pas caché leur intention de régler le « problème tutsi » de façon très brutale. Mais cette perception n’était pas partagée par mes collaborateurs à Paris, et encore moins par le ministère de la Défense, dont je ne dépendais pas hiérarchiquement, étant sous les ordres du ministre de la Coopération. Je ne me suis pas fait entendre. Peut-être n’ai-je pas su convaincre. Je m’interroge encore sur ce point.
– Vous rappelez dans votre livre qu’aussi bien l’ambassadeur de France Georges Martre que l’attaché de défense, le lieutenant-colonel René Galinié, alerte Paris dès le mois d’octobre 1990 sur le risque de liquidation des Tutsi du Rwanda. A quel moment est-ce que vous-même relayez l’information auprès de votre ministre, qui est à l’époque Jacques Pelletier ?
– Jacques Pelletier n’a été que très peu de temps mon ministre. Je ne me souviens pas lui avoir parlé de ce problème. J’en ai parlé avec Edwige Alice et avec son successeur Marcel Debarge
– Et quelle est la réaction de ces ministre successifs de la Coopération, Edwige Alice puis Marcel Debarge ?
– Ils étaient beaucoup moins sensibles que moi à ce problème.
– Vous avez accompagné votre ministre Marcel Debarge au Rwanda début 1993. On raconte qu’il a fondu en larmes en visitant des camps de déplacés de guerre aux abords de Kigali. Et surtout qu’il a rencontré les leaders des partis politiques pour leur conseiller de se rassembler en un « front commun » contre le FPR. Or ce concept de « Front commun » a été perçu comme l’incitation de Paris à créer un « front racial » anti-FPR, d’où la création des mouvements « power » au sein des partis politiques. Vous vous souvenez de ça ?
– Marcel Debarge considérait sa nomination comme une période transitoire avant les législatives. Il ne connaissait pas l’Afrique. Il était effectivement très émotif. Incontestablement, son appel à un « front commun » anti-FPR a été une formulation impulsive et malheureuse.
– Revenons sur une anecdote significative : lors de votre venue au Rwanda en décembre 1990, le responsable de la gendarmerie rwandaise, le colonel Rwagafilita, vous demande des armes lourdes et vous dit : « Nous sommes entre militaires et je vais vous parler plus clairement. La gendarmerie a besoin de ces armes car elle va participer à la résolution de notre problème avec les Tutsis : ils sont très peu nombreux, nous allons les liquider et cela ira très vite ».
Vous rencontrez aussi à plusieurs reprises le colonel Serubuga qui commande les Forces armées rwandaises (FAR) et qui vous fait comprendre, dites-vous « que le génocide est une des solutions envisagées ».
Tout cela date-t-il de la fin 1990 ? J’ai noté que le 14 décembre 1990, vous rencontrez à Kigali le président Habyarimana avec l’ambassadeur Georges Martres, le colonel du Plessis et le colonel Galinié.
– En effet l’entretien que je venais d’avoir avec le patron de la gendarmerie rwandaise m’avait beaucoup inquiété. J’ai donc demandé cette rencontre par l’entremise de l’ambassadeur de France. Je raconte dans mon livre que Habyarimana s’est mis en colère contre le colonel Rwagafilita et m’a annoncé qu’il prendrait des mesures contre lui.
– Vous dites qu’il vous a en quelque sorte promis le limogeage de Pierre-Célestin Rwagafilita. Pourtant il ne l’a pas fait. Rwagafilita, le patron de la gendarmerie, et Laurent Serubuga, le patron des Forces armées rwandaises, ont été limogés trois ans plus tard, non pas pour avoir parlé d’exterminer les Tutsi, mais parce que des responsables militaires français avaient dénoncé leur incompétence opérationnelle…
– Juvénal Habyarimana n’a peut-être pas limogé aussitôt le colonel Rwagafilita mais il m’a montré qu’il était choqué de ses propos. Je reste persuadé que Habyarimana craignait le génocide.
– Lorsque vous parlez au président Habyarimana le 14 décembre 1990 et que vous lui expliquez ce que vous avez entendu de la bouche d’officiers supérieurs rwandais, a-t-il l’air étonné ? Vous souvenez vous précisément de sa réaction ?
– Sa réaction n’était pas d’étonnement, mais de mécontentement Il était furieux qu’on m’ait dit ça. Et Habyarimana a ajouté qu’il allait sanctionner le patron de la gendarmerie. Je pensais qu’il l’avait fait. Je reste intuitivement persuadé que Habyarimana n’était pas d’accord avec génocide. Je me trompe peut-être…
– Vous écrivez page 157 : « Mes rapports et télégrammes diplomatiques sont pendant près de trois mois sans ambiguïté : je souligne les risques d’un massacre des Tutsis ».
Pourtant les gouvernements et les présidents français qui se sont succédé depuis 1990 se sont refusés jusqu’à présent à déclassifier deux notes écrites par vous, un TD du 14 décembre 1990 et un autre que vous avez rédigé trois jours plus tard, le 17 décembre. Donc avant et après votre rencontre avec le président Habyarimana. Ainsi qu’un TD du 15 février 1993 sur des livraisons d’armes aux Forces armées rwandaises. Vous vous souvenez de ces trois notes ?
– Comment connaissez-vous les dates de ces trois télégrammes ? Moi-même je ne les ai pas !
– Ce sont les services de l’Elysée qui ont « listé » les pièces susceptibles d’être déclassifiées, dont vos trois notes.
– Je suis ravi de ces précisions. J’aimerais pouvoir relire mes notes de cettre époque.
– Effectivement déclassification ne signifie pas nécessairement ouverture au public. Elles pourraient corroborer les alertes dont vous parlez.
Entre mille et deux mille documents diplomatiques ou militaires français, certains classifiés confidentiels ou secret Défense sont précisément connus sur la période 1990-1994, dont une partie des « archives Mitterrand ». On est étonné de constater qu’après décembre 1990, dans les documents français dévoilés, il n’est que rarement question du risque de génocide des Tutsi. A votre avis, pourquoi ?
– Je vous laisse libre d’interpréter cette lacune.
– Revenons à votre livre. Page 157 vous écrivez : « Je prends progressivement conscience que mes messages gênent un « lobby » militaire pour qui l’ennemi à combattre est le FPR des Tutsis ». Cette prise de conscience de l’existence d’un lobby militaire est-elle liée au fait qu’en avril 1991, le général Christian Quesnot devient le chef de l’état-major particulier du président de la République (CEMP) ? Qu’il remplace l’amiral Jacques Lanxade, lequel s’inquiétait du risque d’enlisement des militaires français au Rwanda ? Que c’est le général Quesnot qui dorénavant assiste et conseille le président dans son rôle de « chef des armées » ? Et qu’il s’est choisi pour adjoint le colonel Jean-Pierre Huchon, ce dernier, à ma connaissance, intriguant pour obtenir votre place ?
– Je ne souhaite pas citer telle ou telle personne pour incriminer son rôle.
– Dans votre livre, vous décrivez le général Huchon venant avec son uniforme tout neuf de général raser les murs de la cour de la rue Monsieur pour rencontrer le ministre, à votre insu croyait-il, quelques jours avant votre limogeage officiel ?
– Je décris une scène de ce genre, mais c’est vous qui l’interprétez comme concernant Jean-Pierre Huchon. Vous avez constaté que dans mon livre je ne le cite pas. Je ne souhaite pas qu’on s’étende sur ce sujet. Je me contenterai d’observer que le colonel Huchon a obtenu le grade de général pour me succéder au ministère de la Coopération.
– Permettez-moi de revenir sur une question de procédure administrative. Comme le général Quesnot l’a déclaré devant la mission d’information parlementaire, chaque lundi après-midi se tenait une réunion, généralement en cellule de crise, au Quai d’Orsay, coprésidée par le directeur du cabinet du ministre et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Y participaient : pour la Présidence de la République, le chef de l’état-major particulier ou son adjoint et le chef de la cellule africaine ; pour Matignon, le conseiller diplomatique et le chef du cabinet militaire ; pour la Défense, le directeur de cabinet du ministre ou son représentant, le chef du cabinet militaire ou son adjoint, le chef d’état-major des Armées ou son sous-chef des opérations ; pour la Coopération, le directeur de cabinet et le chef de la mission militaire de coopération – c’est à dire vous-même.
On sait que la question de la guerre au Rwanda était à l’ordre du jour de chaque réunion ou presque. A partir de quand en est-on venu à parler des Tutsi comme des ennemis de la France ?
– Je n’assistais pas à chacune de ces réunions, et je n’en garde pas de souvenirs précis. Concernant votre formulation, il ne me semble pas qu’on en soit venu à venu à parler des Tutsi comme des ennemis de la France. En tout cas, pas de façon aussi directe.
– Je reformule ma question : à partir de quel moment, dans les réunions de travail, dans les conversations formelles ou informelles, l’idée que les Tutsi étaient les ennemis de la France commence-t-elle à émerger ?
– J’ai du mal à me souvenir de ces réunions de crise. Donc je ne peux répondre précisément à votre question.
– Excusez-moi d’insister sur ce que vous écrivez page 157 : « Je prends progressivement conscience que mes messages gênent un « lobby » militaire pour qui l’ennemi à combattre est le FPR des Tutsis ». Est-ce à l’occasion de ces réunions en cellule de crise, au Quai d’Orsay ?
– Honnêtement, je ne peux vous répondre précisément. Mais cette prise de conscience progressive, je la confirme.
– Vous citez ce que vous appelez une « première sonnette d’alarme » : vous êtes exclu d’une mission de juillet 1991 au Rwanda. Elle est composée de Jean-Christophe Mitterrand, du diplomate Paul Dijoud et de colonel Jean-Pierre Huchon, alors adjoint du chef de l’état-major particulier du président de la République. On a des raisons de penser que les hauts gradés rwandais leur mettent sous les yeux de fausses interceptions radio du FPR pour les persuader que l’agenda du Front patriotique est d’exterminer les Hutus… et donc que Paris pourrait consentir à l’idée d’une éventuelle extermination préventive des Tutsi…
– Je me souviens de cette mission et de l’humiliation que j’ai ressentie de ne pas en faire partie. Je connaissais tous les intervenants et je pensais que mon point de vue serait utile. Mais ce qui s’est dit ou fait lors de cette mission, je n’en ai jamais été informé.
– Même pas par une note de la DGSE ?
– Non.
– On sait, notamment par la lecture de ses mémoires, que Roland Dumas, le ministère des Affaires étrangères, ne s’intéressait pas au Rwanda, et qu’il avait abandonné ce dossier à Paul Dijoud, ex-politicien giscardien rallié à François Mitterrand, nommé Directeur des affaires africaines et malgaches. Or ce dernier se pliait aux desiderata des militaires de l’Elysée…
– Je ne dirais pas que Monsieur Dijoud « se pliait aux desiderata des militaires de l’Elysée » Je dirais plus simplement qu’il tenait compte de leurs points de vue
– En septembre 1991, dans le cadre de ses fonctions, Paul Dijoud avait invité au Quai d’Orsay le major Paul Kagame chef de la rébellion à l’époque, avec son staff rapproché. Jean-Christophe Mitterrand, alors conseiller pour les Affaires africaines au cabinet présidentiel, était présent, et nous sommes donc dans l’épure de la mission au Rwanda des deux Français. Selon le témoignage de Paul Kagame et des Rwandais francophones qui l’accompagnaient, Paul Dijoud lui aurait prédit : « Si vous n’arrêtez pas le combat, si vous vous emparez du pays, vous ne retrouverez pas vos frères et vos familles, parce que tous auront été massacrés.. »[i] De curieux propos pour un supposé facilitateur ?
– Comme chef de la Mission Militaire de Coopération au ministère de la Coopération, je n’ai pas été mis au courant de cette rencontre, et pas davantage informé de ce qui s’était dit. Je ne l’ai découvert que très tardivement, bien après ma démission de l’armée.
– Fin 1990-début 1991, Paris a envoyé au Rwanda le colonel Gilbert Canovas, conseiller du chef d’état-major de l’armée rwandaise (c’est à dire conseiller du président Habyarimana). Gilbert Canovas était un spécialiste de ce qu’on appelait en Algérie « l’action psychologique ». Dès lors, la guerre civile au Rwanda ne bascule-t-elle pas dans les trucages et la désinformation ?
– Je constate que vous avez plus approfondi ces questions que je ne l’ai fait.
– C’est surtout le journaliste Patrick de Saint-Exupéruy, dans son livre « L’Inavouable », qui a démontré que, avec les préconisations du colonel Gilbert Canovas, Paris encourageait au Rwanda une guerre secrète, jouant en quelque sorte à l’apprenti sorcier… ?
– A l’origine, de par mes fonctions de patron de la coopération militaire, tous les militaires français au Rwanda dépendaient de moi. Le colonel Canovas a été effectivement mis à la disposition du président rwandais mais il n’était pas sous mes ordres. Je ne me souviens pas de contacts avec lui. Vraisemblablement je n’en ai eu aucun.
– Ne peut-on fixer la date du début de votre marginalisation au début 1991, dès l’intervention du colonel Gilbert Canovas au Rwanda au plus haut niveau, sans qu’il doive vous rendre compte de sa mission,?
– Non, je ne peux dater précisement le début de ma marginalisation qui ne s’est faite que progressivement à partir de juillet 91 puis plus clairement ,à mes yeux, avec mes relations avec le Dami du 1er RPIMA comme je le relate dans mon livre.
– Permettez-moi de revenir sur un épisode crucial de la guerre civile : en décembre 1991 le président Habyarimana réunit une commission d’officiers supérieurs dont il confie la présidence au colonel Théoneste Bagosora, avec pour mission de définir l’ennemi. Le résultat est un document qui définit l’ennemi intérieur comme le Tutsi. Avez-vous été informé de cet épisode ?
– Je n’en ai pas été informé, ni avant, ni après.
– Même pas par une note de la DGSE ?
– Non.
– Vous racontez avoir appris au Rwanda début 1993 que les hommes du Détachement d’assistance militaire et d’instruction (DAMI)[ii], désobéissant à vos ordres de neutralité, avaient mené une opération en Ouganda. Pouvez-vous nous en dire plus ?
– Cet incident est apparu après la création du Commandement des opérations spéciales (COS). Parmi les Forces spéciales figuraient en bonne place les militaires du 1er RPIMa, qui se trouvaient au Rwanda pour protéger les ressortissants français. Cette compagnie du 1er RPIMA était installée dans un camp à l’Est du Rwanda. Je suis allé l’inspecter. C’est lors que j’apprends que la compagnie a effectué une opération typique du 1er RPIMa : une infiltration en Ouganda pour collecte de renseignements. Je suis furieux de cette atteinte à la neutralité des militaires français au Rwanda. Donc je réunis la compagnie au complet et je lui adresse une admonestation. De retour à Paris, quelques jours plus tard, je découvre une note sur mon bureau qui m’indique : « les DAMI ne sont plus sous vos ordres ». Est-ce la conséquence d’une volonté de m’écarter, ou bien ai-je dérangé le mécanisme du Commandement des opérations spéciales alors en phase d’expérimentation ? Je ne peux me prononcer. Au Rwanda, les Forces spéciales n’étaient plus sous l’autorité du chef de la Mission Militaire de Coopération mais dans une structure particulière. J’ai posé la question à l’amiral Lanxade, et il m’a répondu qu’effectivement le COS ne figurait plus dans la hiérarchie militaire habituelle. Donc, selon lui, qu’il ne s’agissait pas d’une mesure de défiance à mon égard. L’explication vaut ce qu’elle vaut…
– La création officielle du Commandement des opérations spéciales (COS), qui relève directement du chef d’état-major de l’armée française, date du 24 juin 1992, sans que vous ayez été informé des conséquences dans votre champ de compétences. Tout ceci semble la marque d’une certaine opacité ?
– Incontestablement..
– N’y a-t-il pas un lien entre les opérations secrètes menées par le 1er RPIMa en Ouganda et la visite au Rwanda les 13-14 octobre 1992 du général Quesnot, chef d’état-major particulier du président Mitterrand ? Il visite les trois secteurs principaux de la frontière nord et rencontre le chef d’état-major de l’armée rwandaise, le ministre de la Défense, le Premier ministre et le chef de l’État. Que se sont-ils dit ? Le général Quesnot a-t-il pris des engagements « spéciaux » à cette occasion ?
– Je vous suggère de lui poser directement la question.
– Combien de jours se sont écoulés entre vos remontrances aux hommes du DAMI et la note qui vous retire toute autorité sur eux ?
– Quelques jours. De mémoire, trois ou quatre jours. Ca montre que la hiérarchie militaire habituelle était court-circuitée.
– Cette période de début 1993 est celle d’une activité fiévreuse de Paris au Rwanda, en raison de la situation politique rwandaise très dégradée et aussi de l’offensive militaire du FPR qui manque de peu la prise de Kigali. Noroît reçoit comme mission l’assistance opérationnelle d’urgence aux forces armées rwandaises et la protection de Kigali, comme le raconte le colonel Tauzin (aujourd’hui général de réserve) dans son livre « Rwanda : je demande justice pour la France et ses soldats ». Vous écrivez : « Je gêne car je ne suis pas dans le camp des amis des Hutus que l’on doit aider à combattre les Tutsis » ?
– Oui, c’est ainsi que je peux résumer la situation. Personnellement, je tenais à respecter les directives officielles : les militaires français au Rwanda devaient éviter tout ce qui ressemblait à un engagement direct. Ils étaient chargés de former, de conseiller, mais certainement pas d’intervenir dans le conflit.
– Pourtant, lorsque le Dami passe sous les ordres du colonel Dominique Delort, il mène au Rwanda des opérations dépourvues de neutralité, comme l’installation de barrages qui interdisent l’entrée de Tutsi à Kigali. On signale un certain nombre de bavures à ces barrages, peut-être pas autant que le documente le « Rapport Mucyo »[iii]. Mais l’impression générale est que les militaires français se comportent vis-à-vis des Tutsi un peu comme les gendarmes français à l’encontre des Juifs durant l’Occupation (je possède un certain nombre de témoignages à ce sujet). Vous êtes informé des dérapages commis par des militaires français au Rwanda avant votre limogeage ?
– Vous comprenez pourquoi j’ai été « privé » de la gestion de ce problème…
Il y a des raisons de penser que certaines déficiences et erreurs de l’intervention militaire française au Rwanda sont liées à la création en 1992 de la Direction du Renseignement militaire (DRM). Comment expliquez-vous les différences d’analyse sur le Rwanda entre la DRM et la DGSE, puisque vous avez été en mesure de comparer quotidiennement les « points de situation » de ces deux services ?
– J’ai effectivement constaté des différences d’appréciation qui m’ont surpris. Je l’ai regretté. Le patron de la DRM était l’un de mes amis, j’ai cherché à prendre contact avec lui, sans succès.
– Vous n’aimez pas citer des noms, mais il s’agissait du général Heinrich, un ancien de la DGSE qui a été le premier patron de la DRM ?
Effectivement. Je le connaissais bien. Je l’ai croisé beaucoup plus tard lorsqu’il était comme moi en « deuxième section », mais nous n’avons pas abordé cette question.
– Pour avoir pu consulter un échantillon de « points de situation » de la DGSE et de la DRM et j’ai été frappé d’une certaine partialité de la DRM. Les notes du Renseignement militaire alimentent à l’évidence une forme d’animosité de Paris à l’encontre des Tutsi…
– J’écris dans mon livre que j’ai pris conscience un peu tard que la situation de belligérance au Rwanda, qui m’est d’abord apparue comme un problème militaire, était en réalité un problème politique. Je le regrette, car tout au long de ma carrière, je n’ai jamais joué la carte politique. Au Rwanda il fallait le faire, et je n’ai pas voulu le faire.
– Au début de 1993 le chef d’état-major des armées, l’amiral Lanxade, vous a demandé de rester à votre poste une quatrième année, donc jusqu’à l’été 1994, alors qu’au mois de mai 1993 le ministre Michel Roussin vous « libère ». Comment Roussin peut-il aller à l’encontre de la volonté du chef d’état-major ?
– Je connaissais très bien Michel Roussin, il était un ancien militaire. J’étais content d’avoir pour ministre un homme qui connaissait la chose militaire et avec qui le dialogue était facile. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il me remettait à la disposition du ministère de la Défense., il m’a répondu qu’il ne savait pas.. J’ai cherché à le revoir depuis, vainement. Tout ceci est très complexe. Il y avait effectivement ce que j’appelle, de façon peut être trop ramassée, un « lobby militaire » à l’œuvre à l’Elysée. Il y avait des perceptions différentes du dossier Rwanda. Moi, je m’en tenais bêtement aux directives reçues, y compris de l’amiral Lanxade : « Vous ne prenez pas position ». Or des militaires ont pris position. Même au niveau de la DGSE et de la DRM.
– Comment analysez-vous la position de l’amiral Lanxade ? A la fin de son mandat de chef d’état-major particulier du président de la République, il se montrait très réservé sur l’engagement militaire français au Rwanda. C’est clair dans plusieurs de ses notes aujourd’hui connues. On peut imaginer qu’il partageait votre ligne de conduite et pas du tout les vues de celui qui lui a succédé, le général Christian Quesnot ? Vous écrivez, je cite, « Comment expliquer la mainmise de quelques militaires de l’état-major des armées et de l’état-major particulier du président de la République sur les décisions politiques ». Vous pensez que le président Mitterrand était manipulé par Quesnot et son groupe ?
– La question est de savoir s’il avait l’oreille du président ou pas. Ma réponse serait probablement « oui ». L’amiral Lanxade devait en tenir compte.
– Vous laissez entendre qu’au Rwanda, un certain pouvoir parallèle était à la manœuvre. Mais les hiérarchies parallèles, ce n’était pas un sujet neuf pour vous. Dans un documentaire sur la guerre du Biafra, on rappelle que vous avez été envoyé au Gabon et que votre mission consistait à protéger l’aéroport où transitait l’aide discrète française aux rebelles biafrais. On lit dans le résumé de l’émission : « Jean Varret découvre le monde des mercenaires, le monde de Foccart, un univers séduisant pour ce soldat professionnel qui côtoie alors les « soldats de l’ombre » et comprend mieux comment une politique officielle peut être doublée par une politique parallèle. »
Politique parallèle, n’est-ce pas ainsi qu’on peut qualifier l’action de l’Elysée au Rwanda ?
– La comparaison est peut-être osée. Le Gabon, c’était à la fin des années 1960. Je n’étais alors que capitaine et la « France-Afrique était une évidence. Je ne crois pas trouver d’analogie avec ce que j’ai connu sur le rôle de Paris au Rwanda.
– Je reviens au général Quesnot. En 1995, il n’a pas obtenu le poste de chef d’état-major qu’il espérait. L’analyste Jacques Morel écrit qu’il a été jugé responsable du fiasco français au Rwanda… ?
– Je ne peux répondre à cette question faute d’informations.
– Vous écrivez : « Ni le président français ni même sans doute le président rwandais ne pouvaient imaginer qu’un soutien actif de l’armée française impliquait tacitement l’acceptation d’un génocide tutsi »….
– C’est mon point de vue. A mon avis, ni l’Elysée ni les militaires français n’imaginaient que ça pouvait aller jusque là. Et malheureusement ça a été le cas. Je veux dire par là que même s’il y a eu des erreurs de jugement, voir des fautes, le génocide n’était pas une fatalité. Jusqu’à l’attentat du 6 avril 1994, on pouvait empêcher l’extermination des Tutsi.
– J’ai noté le mot « tacite » que vous utilisez. Selon mes propres investigations, à la suite de la mission de Paul Dijoud, Jean-Christophe Mitterrand et Jean-Pierre Huchon au Rwanda en juillet 1991, on peut parler d’un consentement tacite de Paris à une possibilité de génocide des Tutsi. C’est ce qui ressort aussi de la déclaration de Paul Dijoud à Paul Kagame deux mois plus tard. Alors la tragédie se noue ?
– Ce que vous me dites est grave. L’équipe française ne pouvait accepter cette perspective
– Vous parlez dans votre ouvrage du « complexe de Fachoda », une explication déjà avancée par la mission d’information parlementaire sur l’engagement française contre le FPR. Mais vous laissez entendre que ce complexe de Fachoda servait à une sorte de Kriegspiel au Rwanda pour l’entourage de François Mitterrand. Ce qu’on sait sur les archives de l’Elysée semble corroborer ce que vous écrivez : « Toute information soulignant les risques de génocide n’était pas prise en compte et ne montait pas au niveau du président Mitterrand ». Or l’homme qui préparait les parapheurs du président, ce n’était pas le général Quesnot, c’était le secrétaire général de l’Elysée Hubert Védrine. Pourquoi ne le citez-vous pas dans les coulisses de ce que vous appelez « la mainmise de quelques militaires de l’état-major des armées et de l’état-major particulier du président de la République » ?
– Effectivement je m’interroge sur le rôle de Hubert Védrine. J’ai la conviction qu’il s’exprimera un jour sur ce point. C’est un vrai problème. J’ai eu l’impression que Hubert Védrine suivait le dossier de très près et qu’il estimait que le Quai d’Orsay ne s’impliquait pas suffisamment dans la résolution du problème rwandais. Mais je ne me souviens plus à quelle occasion est née cette impression.
– Votre limogeage de chef de la Mission d’Assistance Militaire entraine votre démission de l’armée. Vous écrivez « je n’ai pas attendu le massacre pour faire une nouvelle demande de démission Sans être convaincu que le génocide serait inévitable, ma démission est fondée sur le fait que mes avertissements sur les risques encourus, pas plus que les solutions que je préconisais, n’aient été pris en compte ».
Pouvez-vous nous en dire plus sur vos avertissements et vos préconisations, qui semblent un des secrets les mieux gardés de ce qu’on appelle « les archives de l’Elysée » ?
– J’espère qu’un jour ces archives seront mises à la disposition des historiens, des journalistes et des citoyens. Malheureusement je n’ai pas gardé copie de mes notes de cette époque. Je regrette à présent de ne pas en avoir fait de photocopies.
Mon livre d’anecdotes est fondé sur la consultation de mes seuls agendas et je me méfie des lacunes mnemoniques Je me suis interdit toute élucubration surtout sur le grave sujet du Rwanda
– En 1993, vous faites savoir au président de la République les raisons de votre démission. Il vous fait répondre qu’il n’a jamais eu connaissance de vos télégrammes alarmistes. Le croyez vous réellement sincère ?
– Quand on est chef d’Etat, on est forcément machiavélique. Je pense qu’il était au courant, car un chef d’Etat se doit d’être au courant de tout .
– Dans son livre de souvenirs « Le Pouvoir ne se partage pas », Edouard Balladur, le Premier ministre de l’époque, insinue que François Mitterrand était alors dans un état physique et moral qui le rendait inapte à gouverner. Vous qui l’avez rencontré à cette époque, partagez-vous cette analyse ?
– Il me semble que la maladie dont il souffrait alors beaucoup, diminuait sa capacité de réaction. Peut-être son entourage en a-t-il profité. Quand je l’ai vu une dernière fois, il regrettait ma demande de démission et voulait me convaincre de ne pas quitter l’armée
– Sur le rôle de Paris dans le génocide des Tutsi du Rwanda, vous soulignez « la complexité du fonctionnement de l’Etat et les lacunes graves de ce fonctionnement au point de laisser faire le génocide laissant libre cours aux hypothèses les plus graves sur le comportement de ce lobby militaire ». Et vous ajoutez « les militaires ne peuvent dicter au pouvoir politique sa conduite à tenir, y compris dans les moments de conflits armés ». Est-ce le scénario de la tragédie de 1994 au Rwanda ? Un génocide que des militaires français ont délibérément laissé se préparer ?
– « Délibérément », le terme me semble excessif. Je dirai plutôt que les militaires français avaient un rôle à jouer pour éviter le génocide des Tutsi. Et je regrette qu’ils n’aient pas tous agi dans ce sens.
Propos recueillis par Jean-François DUPAQUIER
___________________
Droit de réponse
A la suite de la publication de cet article, le colonel Serubuga, a tenu à nous faire parvenir ce droit de réponse :
« Le colonel Serubuga entend réagir aux passages relatant sa rencontre avec le général Varret. Contrairement à ce que dit l’article, l’entretien portait uniquement sur les manifestions organisées par les partis d’opposition contre le pouvoir du président Habyarimana, prévues en février 1992, et non pas sur le génocide intervenu deux ans plus tard.
Lors de cet entretien, le général Varret a fait part au colonel Serubuga, de même qu’au colonel Rwagafilita et au président Habyarimana, du souhait du président français de voir ces manifestations se tenir, afin de préserver l’objectif de démocratisation du pays. Le colonel Serubuga lui a répliqué que ces manifestations n’étant pas sécurisées, ils craignaient une infiltration et une récupération du FPR, avec un risque important de troubles intérieurs au détriment de la population et de la protection du front. A la suite de ces discussions, les ordres militaires concernant ces manifestations ont été rectifiés et les paras-commandos sont restés au front pour protéger la frontière.
Le génocide est survenu en 1994, soit deux ans après cet entretien et deux ans après le départ du colonel Serubuga de l’armée rwandaise.
En 1990, le terme de génocide n’était pas encore employé, il ne le sera qu’après les tristes événements de 1994. Trop souvent, des raccourcis de langage sont utilisés pour évoquer la période antérieure à 1994, avec une tendance à tout voir sous le prisme du génocide de 1994, ce qui peut susciter de graves confusions, comme c’est le cas en l’espèce. »
___________________
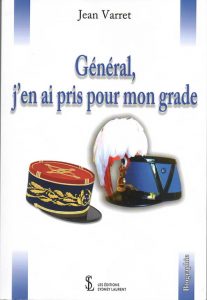 Jean Varret, « Général, j’en ai pris pour mon grade », Editions Sydney Laurent, Paris, 2018
Jean Varret, « Général, j’en ai pris pour mon grade », Editions Sydney Laurent, Paris, 2018
[i]Interrogé par Le Figaro en 1998, Paul Dijoud affirmera ne pas se souvenir de cette visite, et pas davantage des propos qui lui sont prêtés par la délégation du FPR.
[ii] [ii] DAMI : Détachement d’assistance militaire et d’instruction. Les DAMI regroupent, dans le cadre d’accords militaires, un certain nombre de militaires français charges d’instruire ou de parfaire l’aptitude des forces régulières des pays signataires dans divers domaines tels que le tir, le combat, les transmissions, l’entretien des véhicules ou la police judiciaire.
[iii] Jean-de-dieu Mucyo (aujourd’hui décédé) était le rapporteur de la Commission Nationale Indépendante chargée de rassembler les preuves montrant l’implication de l’Etat Français dans le génocide perpétré au Rwanda en 1994. Il a donné son nom au volumineux rapport (331 pages) publié en août 2008 à Kigali, qui accuse Paris et les militaires français de très graves exactions.
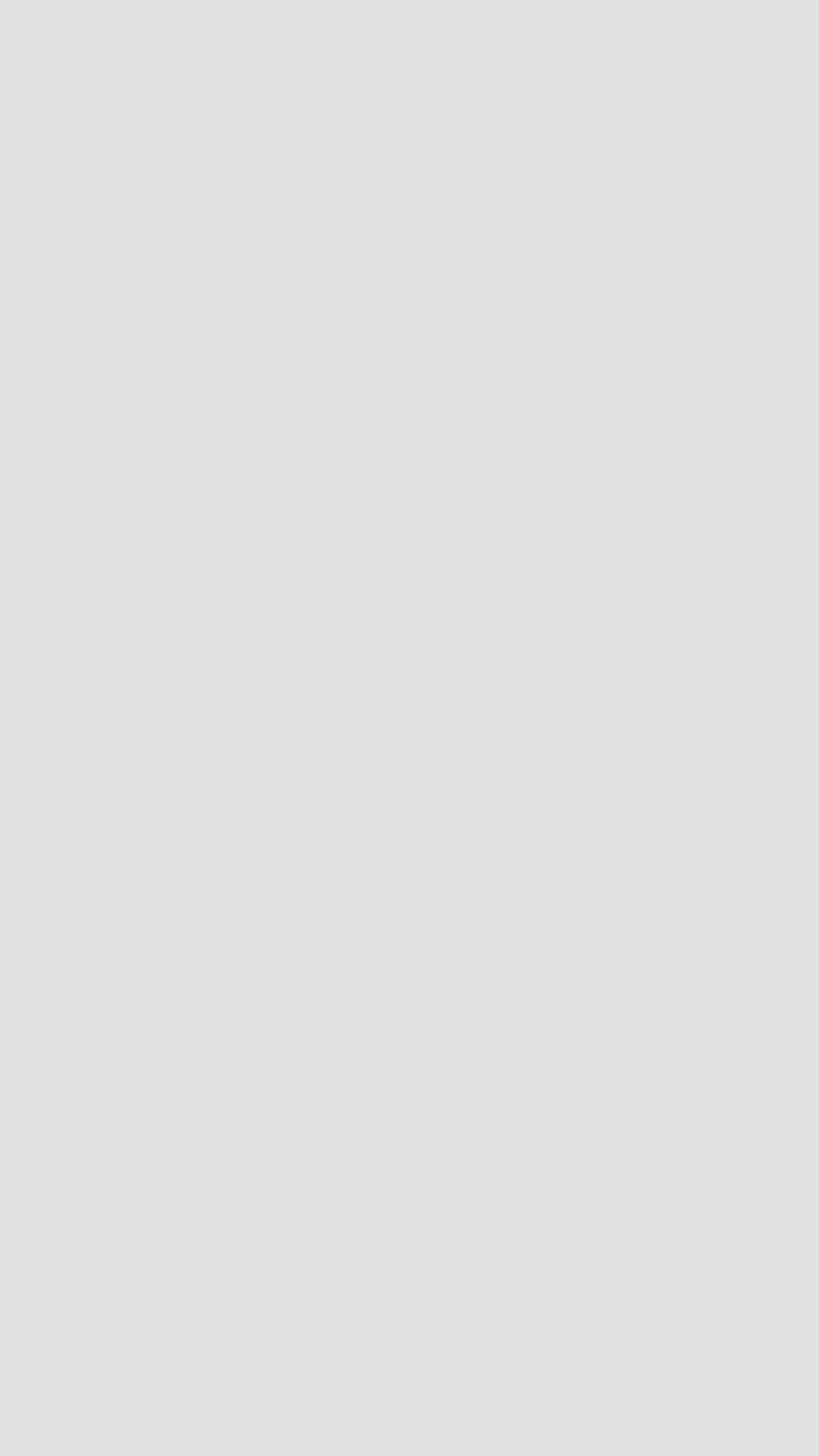


 envoi en cours...
envoi en cours...

















