Le Sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique se tiendra le 6 et 7 décembre à Paris. Une occasion de faire le point sur la politique africaine de François Hollande, hésitante et dictée par les interventions militaires.

Une quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement se réuniront à l’Elysée pour le Sommet Afrique-France © Ch. Rigaud
« Doctrine« , « philosophie« , « méthode« … ces mots sont martelés à plusieurs reprises par Paul Jean Ortiz, le sherpa de François Hollande et Hélène Le Gal, conseillère Afrique de la présidence. Venu présenter à la presse le Sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique du 6 et 7 décembre, l’entourage de François Hollande a tenté de définir les contours de la politique africaine de la France. Des contours encore flous.
Le Sommet Afrique-France auquel une quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement assisteront, tournera autour de trois thématiques : la paix et la sécurité, le partenariat économique et le développement ainsi que le changement climatique. Si l’économie est une priorité clairement affichée de la France, avec pour objectif de regagner les parts de marché perdus, c’est bien la sécurité qui sera au coeur du grand raout élyséen.
Depuis l’intervention française inattendue au Mali début 2013, François Hollande semble s’être résigné à jouer la carte militaire en Afrique. L’opération Serval constitue bel et bien l’acte fondateur d’une doctrine africaine jusque là hésitante. La bonne vieille recette de l’intervention militaire fonctionne toujours : prestige international immédiat, poids accru au Conseil de sécurité de l’ONU et espoirs de retombées économiques en provenance d’un continent en constante croissance.
Grâce à l’armée française, s’est élaborée la nouvelle « philosophie » d’une politique africaine. Hélène Le Gal explique que la France intervient désormais militairement pour « soutenir » et « rendre opérationnelles » les forces africaines « en attente« . En clair : donner le « coup de pouce » militaire nécessaire dans un conflit, en attendant la mise en place de forces africaines, comme c’est le cas au Mali avec la Minusca ou en Centrafrique avec la Misca.
A cette politique africaine « de circonstance« , plusieurs questions. Et tout d’abord : quelle différence avec la politique menée par Nicolas Sarkozy, qui est lui aussi intervenu en Côte d’Ivoire et en Libye ? Lors de la conférence de presse de présentation du Sommet, une question taquine est venue semer le trouble à la tribune dans le ronron de l’hôtel Marigny : « C’est quoi une politique africaine de gauche ? » Silence. Le sherpa de François Hollande se lance : « on pourrait dire : l’esprit de dialogue et le respect des institutions africaines« . François Hollande joue effectivement plus « collectif » que son prédécesseur et les décisions françaises sont concertées avec les partenaires africains, via l’Union africaine (UA) qui occupe désormais une place centrale dans ce Sommet. Pour le reste, Paul Jean Ortiz laisse le soin aux commentateurs et aux journalistes de définir ce qu’est une « politique africaine de gauche« . Nous n’en saurons donc pas plus.
Un second journaliste tente sa chance et demande quelles sont différences avec les autres Sommets africains. Réponse du responsable de la logistique : « un coût sensiblement inférieur aux autres Sommets puisque tout se passe à Paris dans des installations et des lieux existants« . Visiblement, c’est tout ce qui saute aux yeux pour les organisateurs du Sommet. Bien maigres ambitions.
Pourtant, il y a beaucoup à dire sur ce Sommet. Plusieurs grands sujets sont absents du rendez-vous élyséen… et non des moindres : la démocratie, les Droits de l’Homme et… concept qui ne semble plus à la mode : la « bonne gouvernance« . Dans la liste d’invités au Sommet : des régimes et des présidents plus ou moins fréquentables. On pense au tchadien Idriss Déby qui réprime à tout va son opposition et « fait le ménage » dans son propre camp, en toute impunité. Depuis le soutien du Tchad à l’opération Serval au Mali, Déby paraît « intouchable »… et le fait savoir. Idem pour Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, qui, après des élections contestables en 2011, maintient plusieurs dirigeants politiques en prison comme Eugène Diomi Ndongala. A Kinshasa, fin novembre, le président Kabila a également donné le feu vert à une opération de « nettoyage » de la délinquance très « musclée« , au bilan sans appel : 20 morts dont 12 enfants ! L’Unicef et la Monusco dénoncent des exécutions « extrajudiciaires ». Le camerounais Paul Biya est responsable, selon Amnesty International, « d’exécutions illégales » et « d’actes de torture« . Que dire également de la police du président de Djibouti Ismaël Omar Guelleh qui tirait en mars dernier sur des manifestants. Triste bilan : 10 morts et 900 opposants emprisonnés. Sur ces questions : silence radio pendant le Sommet.
L’armée française constitue donc toujours le meilleur atout de la diplomatie française et principalement en Afrique. En 50 ans, la France est intervenue 50 fois sur le continent. Qui dit mieux ? A court de positionnement, le président français a su saisit les opportunités militaires qui se présentaient : le Mali d’abord, avec un succès militaire rapide (mais peut-être pas durable), et la Centrafrique aujourd’hui. Seul changement avec les méthodes du passé : l’aide militaire prend un autre visage. C’est Hélène Le Gal qui le précise devant les journalistes du Sommet : « On envoie plus de matériels militaires en Afrique, c’est fini, les Africains ont maintenant les moyens de s’acheter ce qu’ils veulent. Nous intervenons désormais sur l’aide à la planification militaire des troupes africaines. Sur les moyens aériens et sur la formation. » Le différence serait donc là.
Christophe RIGAUD – Afrikarabia
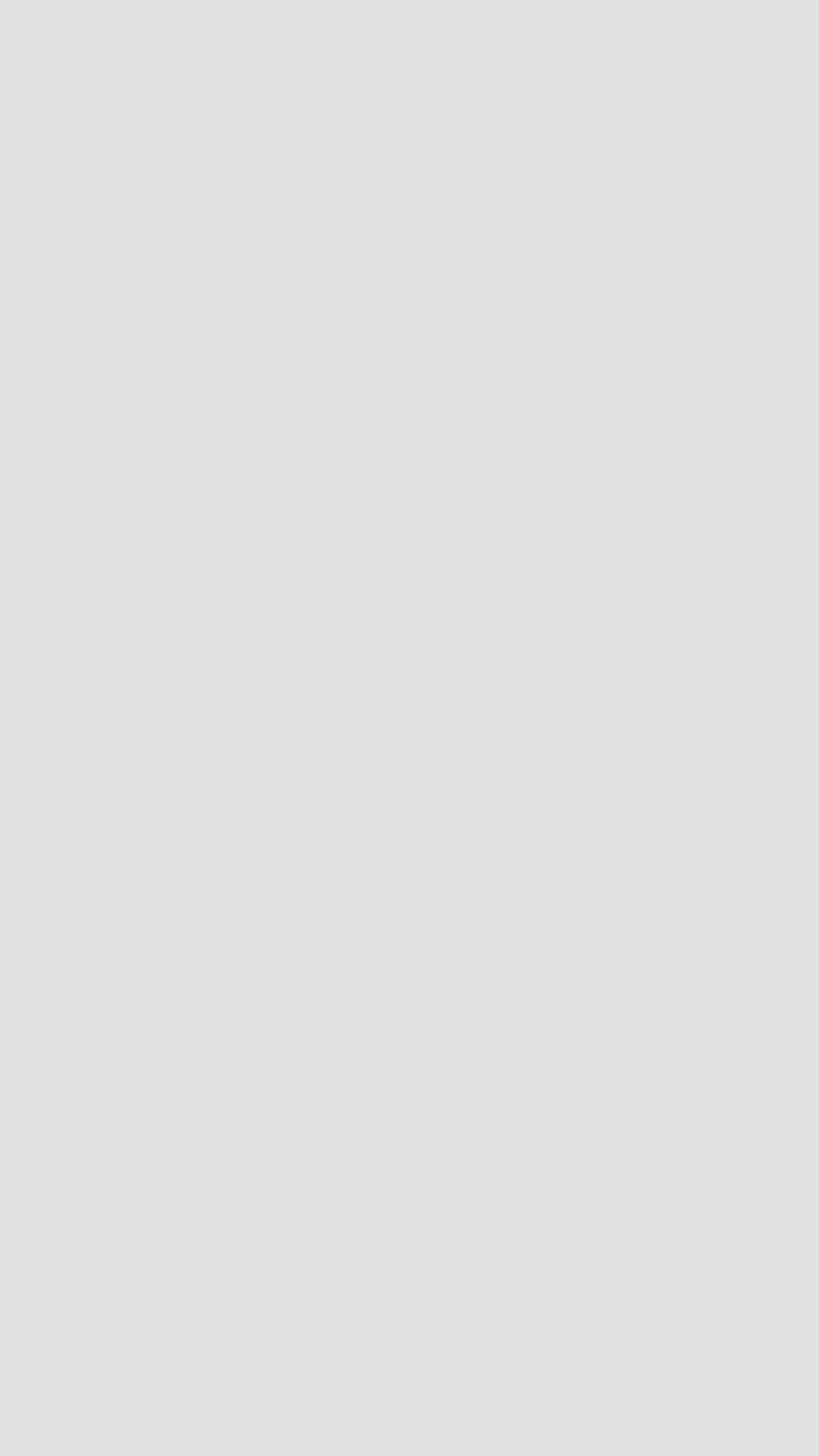

 envoi en cours...
envoi en cours...

















